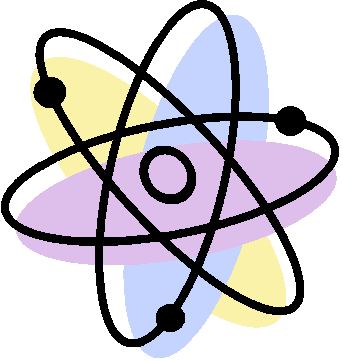Alors que la place de l’énergie nucléaire dans le mix électrique est souvent mise en cause, elle ne représentait, en fait, que 11% de la production mondiale d’électricité en 2016 (75 % en France) et sa part évolue peu (437 réacteurs soit 413 GW). Un récent rapport de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie, Energy Technology Perspectives 2017, www.iea.org ) fait, un certain nombre d’observations intéressantes sur son avenir. Il apparaît ainsi que pour la première fois depuis 1990, l’année 2016 a été particulièrement « faste » pour le nucléaire, dans la mesure où des nouveaux réacteurs représentant une puissance de 10 GW, ont été raccordés à des réseaux. L’AIE observe, toutefois, que ces dix dernières années, une moyenne annuelle de 8,5 GW a été mise en service alors que son scénario énergétique limitant à 2°C le réchauffement climatique « prévoit » un objectif annuel de 20 GW. Elle envisage un scénario où la part du nucléaire dans le mix électrique mondial passerait à 15% en 2060 dans un contexte de croissance de la production mondiale d’électricité. Elle note, toutefois, que, fin 2016, seuls dix états sur 163 avaient mentionné le nucléaire dans leur stratégie de réduction des émissions de gaz à effets de serre qu’ils avaient communiqué à l’ONU suite à l’accord de Paris.
Les pays asiatiques ont les objectifs les plus ambitieux : la Chine prévoit de doubler d’ici 2020 sa capacité nucléaire pour la porter à 58 GW et avec 30 GW en construction en 2020, la Corée du Sud ambitionne de porter sa puissance nucléaire de 23 GW en 2016 à 38 GW en 2029 mais son nouveau président envisage l’abandon du nucléaire…. L’Inde produit 60% de son électricité avec du charbon mais prévoit d’en produire le quart avec du nucléaire en 2050 (5 GW en 2015), quant au Japon il redémarre avec difficulté ses réacteurs nucléaires (cinq en service en juin 2017) arrêtés après Fukushima. La situation est plus contrastée aux Etats-Unis (le tiers de l’électricité nucléaire mondiale) où la relance du nucléaire se fait attendre car elle subit la concurrence du gaz de schiste. En Europe, après la sortie de l’Allemagne du nucléaire et la récente décision de la Suisse de la suivre, la Suède, la Finlande, certains pays d’Europe orientale et la Russie maintiennent leurs investissements dans le nucléaire que relance la Grande Bretagne avec la construction de deux réacteurs EPR par EDF à Hinkley Point C. Quant à la France, elle doit plafonner sa capacité nucléaire à 63,2 GW (sa puissance actuelle) tout en abaissant à 50% sa part du nucléaire dans sa production électrique.
Aujourd’hui, les réserves mondiales d’uranium assureront l’approvisionnement en combustible des centrales nucléaires jusqu’à la fin du siècle mais la question des réserves se posera si l’option nucléaire est maintenue. En revanche, la question des futures filières est déjà posée (cf. notamment World Nuclear Organization, Advanced nuclear power reactors, janvier 2017, www.world-nuclear.org,). Selon l’AIE, la majorité des réacteurs en construction relèvent de la troisième génération du nucléaire, les EPR et leurs variantes (appelés Advanced Power Reactors ou APR). Ceux-ci ont des systèmes de sécurité renforcés et opèrent avec un meilleur rendement et une durée de vie de 60 ans. Après des retards dans leur construction et d’importants dépassements de coût çon appr(notamment en Finlande et en France à Flamanville, cf. photo chantier Flamanville, source : EDF), les premiers APR ont commencé à produire leurs kWh : le réacteur APR 1400 en Corée du sud en 2016, un réacteur de la centrale de Novovoronezh en Russie d’une puissance de 1200 MWh depuis février 2017, la centrale finlandaise d’Olkiluoto (1700 MW) devant commencer ses essais en juin, le réacteur Taishan 1 (1700 MW) en Chine ayant commencé les siens en 2016, tous deux construits par Areva. Un scénario avec des réacteurs de Génération III mais de plus petite puissance (inférieure à 1000 MW) est aussi envisageable. Le constructeur américain NuScale Power veut tester des petits réacteurs de deuxième génération et il a soumis une demande de certification d’un réacteur de 50 MW à l’autorité de régulation américaine en janvier 2017. Il construirait une centrale de 600 MW constituée d’une douzaine de ces mini-réacteurs, la cuve de chaque unité étant immergée dans une piscine en béton creusée dans le sol, le cœur étant refroidi par une circulation d’eau par convection.
On doit se poser une troisième question : existe-t-il une filière alternative aux réacteurs actuels qui innoverait en matière de sûreté et serait économiquement compétitive ? Les réacteurs de IV e génération seraient une réponse, elle fait l’objet d’une concertation internationale dans le cadre de l’OCDE. La fission est déclenchée en bombardant le combustible, un mélange d’uranium et de plutonium, avec des neutrons à grande énergie. Le réacteur produit in situ de nouvelles charges de plutonium, il fait donc de la « surgénération » (C. Béhar, « Les systèmes nucléaires du futur », Pour La Science, No 456, p. 60, octobre 2015, www.pourlascience.fr ). C’est le grand intérêt de la filière car en utilisant le plutonium on disposerait de plusieurs centaines
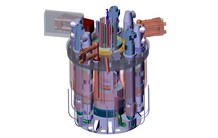
d’années de réserve de combustible. La France construit un nouveau réacteur prototype Astrid de 600 MW (cf photo de la maquette du cœur, photo Cea) utilisant le sodium liquide comme fluide caloporteur (une option à l’hélium étant possible). Le Japon a décidé, quant à lui, de fermer son réacteur expérimental Monju utilisant le sodium. La filière ne sera crédible que si sa sûreté est assurée, ce qui n’est pas acquis (une réponse en 2040 ?). Les réacteurs à « sels fondus » sont une alternative aux réacteurs actuels à uranium, un prototype avait été testé à Oak Ridge, aux États-Unis dans les années 1960 (destiné à un moteur atomique pour les avions !).
Dans ces réacteurs le combustible, du thorium ou de l’uranium, est dissous dans des fluorures de lithium ou de béryllium fondus. Ce liquide sert à la fois de support à la fission et à évacuer la chaleur. Outre sa sûreté, supposée supérieure à celle des actuels réacteurs, cette filière aurait l’avantage d’utiliser le thorium, dont les réserves sont trois fois plus importantes que celles d’uranium, et de produire beaucoup moins de déchets à vie longue ; son combustible serait difficilement utilisable pour fabriquer une bombe atomique, elle serait « non-proliférante ». L’Inde, bien dotée en thorium, expérimente un réacteur de 30 MW, ainsi que la Chine. Aux USA, le consortium ThorCon a conçu un réacteur modulaire fonctionnant avec un fluorure de thorium liquide mélangé à un liquide caloporteur (des fluorures) modéré au graphite, chaque module de 250 MW étant logé dans une cavité souterraine en béton. Si la sûreté et la compétitivité économique des réacteurs de faible puissance était assurée, on pourrait envisager un scénario où un pays se doterait de réacteurs de 100 à 300 MW, moins coûteux, pour conforter la production des filières intermittentes (l’éolien et le solaire), ce serait une nouvelle donne nucléaire.
Le nucléaire doit enfin résoudre deux questions importantes : le prolongement éventuel de l’activité des réacteurs « âgés » et le stockage des déchets nucléaires. La première se pose pour les réacteurs de plus de quarante ans d’âge en France (c’est le cas de ceux de Fessenheim dont la fermeture a été décidée) mais aussi aux Etats-Unis et au Japon. L’autorisation de prolongation de l’exploitation d’une centrale est donnée par une Autorité de sûreté. Dans une série d’études sur la sûreté des réacteurs français (Are older nuclear reactors less safe? Evidence from incident reports in the French fleet par R.Bizet, P. Bonev, and F. Lévêque, Mines ParisTech, CERNA, février 2017, www.cerna.mines-paristech.fr ), des chercheurs de l’Ecole des mines de Paris ont montré qu’il n’existe pas de fatalité de l’âge pour les réacteurs nucléaires. S’appuyant sur une base de données recensant 19 000 incidents en France, ils montrent que c’est la technologie des réacteurs (leur fréquence n’est pas la même pour les réacteurs de 900 MW et de 1450 MW) bien davantage que l’âge qui joue sur la survenue d’incidents (leur fréquence diffère pour les réacteurs de 900 MW et de 1450 MW et la sûreté a pu être améliorée au cours de leur vie). Autrement dit, on doit tenir compte, en priorité, des spécificités de la technologie d’un réacteur (et de ses faiblesses) pour prendre une décision de prolongation, ou de non-prolongation, de son exploitation (si aucune défaillance n’a été détectée), quitte à réaliser des travaux pour améliorer sa sûreté si leur coût n’est pas prohibitif.
Le stockage des déchets nucléaires radioactifs, notamment ceux provenant des combustibles usagés, est la question ultime qui a rarement trouvé une réponse « définitive ». Un récent incident survenu sur le site de Hanford dans l’Etat de Washington aux USA, en mai dernier, illustre bien l’urgence de gérer le problème de faon appropriée. Sur ce site militaire de production de plutonium, hors de service (le premier réacteur produisant le plutonium des bombes atomiques y a été mis en service en 1943) et transformé en complexe de stockage des déchets sous forme solide et liquide, le toit d’une galerie souterraine où des déchets sont stockés dans des wagons s’est écroulé ; l’accident n’a pas provoqué, semble-t-il, d’émanations radioactives à l’extérieur. Les scientifiques, notamment ceux du Bulletin of Atomic Scientists, ont dénoncé l’incurie de l’administration américaine qui a laissé se dégrader la situation à Hanford et n’a pas trouvé de solution pour un stockage définitif à l’échelle nationale (le projet de construction d’un site souterrain à Yucca Mountain, dans le Nevada à 100 km des casinos de Las Vegas qui semblait abandonné a été ressorti des cartons par l’administration Trump…).
La France, quant à elle, s’est attaquée au problème dans le cadre de la loi Bataille, votée en 1991 : le principe de l’entreposage des déchets à haute activité et moyenne activité et à vie longue dans un site creusé dans une couche géologique profonde a été retenu. L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) a la responsabilité de préparer et de gérer ce stockage (des stockages temporaires sont effectués en surface), c’est le projet Cigéo dont l’intitulé « Centre industriel de stockage géologique » explicite bien la finalité, ce stockage doit être éventuellement réversible (une récupération de déchets à vie longue n’est pas exclue si l’on trouve un moyen  technique pour les transmuter en déchets à vie plus courte). Un site a été choisi à Bure à la limite de la Haute Marne et de la Meuse, pour construire un laboratoire souterrain à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile ; pour l’heure 1600 mètres de galeries ont été creusés (cf. Andra Projet Cigéo , www.andra.fr cf. photo d’une galerie du site, avec les remerciements de l’auteur à l’Andra pour une visite du site). Les conditions de stockage y sont testées in situ ; celui-ci devant être assuré pendant plusieurs centaine de milliers d’années, il faut s’assurer de la stabilité géologique des couches (et matérielle des containers), c’est le cas avec ce type d’argile datant de 160 millions d’années. La robotisation de la manipulation des containers est également testée. La future zone de stockage couvrirait 15 km2 ; après une enquête publique, et sous réserve d’une autorisation de création et après une phase pilote, elle serait mise en service en 2030 avec un coût total estimé à 25 milliards d’euros qu’EDF provisionnera pour les déchets de ses actuels réacteurs (son incidence sur le coût du kWh serait de 1 à 2% selon la Cour des Comptes). Le projet a été l’objet d’une concertation locale mais comme tous les grands projets actuels (de l’aéroport de Notre Dame des Landes au tunnel de la ligne Lyon-Turin, en passant par les fermes éoliennes off-shore…), il suscite des critiques mais quoi que l’on pense de l’avenir du nucléaire, le stockage des déchets nucléaires est « incontournable » si l’on veut éviter des situations à la Hanford, tout en étant conscients que nous les confions aux générations futures… Un récent rapport de l’American Academy of Arts and Sciences de New York ((R.D. Sloan, Multinational storage of spent nuclear fuel and other high-level nuclear waste, a road for moving forward, NewYork 2017, www.amacad.org ) souligne l’urgence du problème et plaide pour des solutions multinationales (celles-ci ne seront pas toujours applicables).
technique pour les transmuter en déchets à vie plus courte). Un site a été choisi à Bure à la limite de la Haute Marne et de la Meuse, pour construire un laboratoire souterrain à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile ; pour l’heure 1600 mètres de galeries ont été creusés (cf. Andra Projet Cigéo , www.andra.fr cf. photo d’une galerie du site, avec les remerciements de l’auteur à l’Andra pour une visite du site). Les conditions de stockage y sont testées in situ ; celui-ci devant être assuré pendant plusieurs centaine de milliers d’années, il faut s’assurer de la stabilité géologique des couches (et matérielle des containers), c’est le cas avec ce type d’argile datant de 160 millions d’années. La robotisation de la manipulation des containers est également testée. La future zone de stockage couvrirait 15 km2 ; après une enquête publique, et sous réserve d’une autorisation de création et après une phase pilote, elle serait mise en service en 2030 avec un coût total estimé à 25 milliards d’euros qu’EDF provisionnera pour les déchets de ses actuels réacteurs (son incidence sur le coût du kWh serait de 1 à 2% selon la Cour des Comptes). Le projet a été l’objet d’une concertation locale mais comme tous les grands projets actuels (de l’aéroport de Notre Dame des Landes au tunnel de la ligne Lyon-Turin, en passant par les fermes éoliennes off-shore…), il suscite des critiques mais quoi que l’on pense de l’avenir du nucléaire, le stockage des déchets nucléaires est « incontournable » si l’on veut éviter des situations à la Hanford, tout en étant conscients que nous les confions aux générations futures… Un récent rapport de l’American Academy of Arts and Sciences de New York ((R.D. Sloan, Multinational storage of spent nuclear fuel and other high-level nuclear waste, a road for moving forward, NewYork 2017, www.amacad.org ) souligne l’urgence du problème et plaide pour des solutions multinationales (celles-ci ne seront pas toujours applicables).
Soixante ans après la mise en service, en URSS et en Grande Bretagne, des premiers réacteurs électronucléaires, force est de constater que le nucléaire pose beaucoup de questions mais aussi qu’il n’a probablement pas dit son dernier mot. Le choix d’une  filière est une décision politique, le référendum suisse le montre, devant tenir compte de trois critères : le possible, le souhaitable et l’acceptable (cf. B.David et al. « Prospectives énergétiques : le possible, le souhaitable et l’acceptable », Futuribes, No 390, p. 5, novembre 2014). S’agissant du stockage souterrain des déchets en France, encadré par la loi, on peut estimer que si les tests sont positifs, les trois critères seront satisfaits (c’est loin d’être le cas aux USA et ce l’est sans doute en Suède). S’agissant des futures filières, un problème technique et industriel, on peut penser que tout le possible est loin d’avoir été exploré (par exemple pour la génération IV, le thorium et les petits réacteurs). Quant à la question du souhaitable, elle est posée, au plan international, par les risques de la prolifération nucléaire.
filière est une décision politique, le référendum suisse le montre, devant tenir compte de trois critères : le possible, le souhaitable et l’acceptable (cf. B.David et al. « Prospectives énergétiques : le possible, le souhaitable et l’acceptable », Futuribes, No 390, p. 5, novembre 2014). S’agissant du stockage souterrain des déchets en France, encadré par la loi, on peut estimer que si les tests sont positifs, les trois critères seront satisfaits (c’est loin d’être le cas aux USA et ce l’est sans doute en Suède). S’agissant des futures filières, un problème technique et industriel, on peut penser que tout le possible est loin d’avoir été exploré (par exemple pour la génération IV, le thorium et les petits réacteurs). Quant à la question du souhaitable, elle est posée, au plan international, par les risques de la prolifération nucléaire.