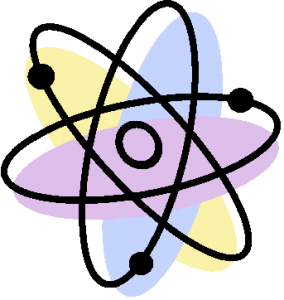 De nombreux scénarios énergétiques publiés ces dernières années faisaient l’hypothèse d’une croissance modérée de la part du nucléaire dans la production mondiale d’électricité. L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, survenu au Japon, a changé la donne : plusieurs pays dont l’Allemagne ont décidé de « sortir » du nucléaire, alors que d’autres comme la Chine maintiennent leur confiance dans la filière. En France la question est posée et un débat s’engagera à l’occasion de la prochaine élection présidentielle en 2012 : quelle sera la place du nucléaire dans le mix énergétique du pays à long terme ? La question est difficile et il est utile d’identifier les paramètres clés du problème.
De nombreux scénarios énergétiques publiés ces dernières années faisaient l’hypothèse d’une croissance modérée de la part du nucléaire dans la production mondiale d’électricité. L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, survenu au Japon, a changé la donne : plusieurs pays dont l’Allemagne ont décidé de « sortir » du nucléaire, alors que d’autres comme la Chine maintiennent leur confiance dans la filière. En France la question est posée et un débat s’engagera à l’occasion de la prochaine élection présidentielle en 2012 : quelle sera la place du nucléaire dans le mix énergétique du pays à long terme ? La question est difficile et il est utile d’identifier les paramètres clés du problème.
La production mondiale d’électricité est assurée, aujourd’hui, à 15 % par du nucléaire et dans un scénario publié en 2010, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) envisageait une croissance modérée de la part du nucléaire à l’horizon 2035 dans la perspective d’ailleurs d’un quasi doublement de la demande mondiale d’électricité. De nombreux experts envisageaient, il y a peu, une "Renaissance " du nucléaire, notamment aux Etats-Unis où il avait traversé une mauvaise passe après les accidents de Three Mile Island (1979) et de Tchernobyl (1986). Avant le séisme de Tohoku, le Japon prévoyait, quant à lui, de doubler d’ici 2030 sa production d’électricité nucléaire, qui représentait avant la catastrophe de Fukushima près de 30% de sa production d’électricité. Sans attendre les résultats de l’enquête sur son déroulement qui sera forcément longue, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse ont d’ores et déjà décidé d’abandonner le nucléaire (une sortie en 2022 pour l’Allemagne). Le Royaume-Uni, en revanche, a décidé de maintenir son choix de relance du nucléaire en construisant de nouvelles centrales, tandis que la Chine, tout en maintenant ses projets en cours, a décidé de geler la mise en chantier de quatre réacteurs dont la construction était décidée. Les pays européens ont décidé de faire subir des "stress tests " à tous leurs réacteurs (EDF a déjà procédé aux siens), quant aux USA, ils donneront probablement une priorité aux centrales à gaz.
En France, le débat sur l’avenir du nucléaire est ouvert (78% de l’électricité y est produite avec le nucléaire, 12% par l’hydraulique, 10% par du thermique classique et du renouvelable). Ainsi, devançant une demande du gouvernement (celui-ci a créé une commission qui étudiera des scénarios énergétiques), le gestionnaire du réseau électrique, RTE (Réseau de transport d’électricité) , a d’ores et déjà réalisé un scénario de réduction à 50% de la part du nucléaire à l’horizon 2030 : il impliquerait la création de capacités de 40 GW d’éolien, de 18 GW de photovoltaïque et d’un capacité de production de 10 GW (du thermique essentiellement) pour passer les pointes de consommation, les énergies renouvelables représentant 38% de la production totale. L’association négaWatt (www.negawatt.org) a publié récemment un scénario très détaillé qui prévoit une sortie du nucléaire en 2033. Ce scénario fait l’hypothèse qu’il est possible de diminuer drastiquement la consommation d’énergie primaire en France (pratiquement d’un facteur trois) et de réaliser une transition énergétique qui conduirait à se passer de presque toute énergie carbonée non renouvelable (pétrole, charbon, gaz) et de toute production d’électricité par le nucléaire. L’abandon du nucléaire se réaliserait en fermant par étape des tranches nucléaires jusqu’en 2033. Dans le débat pour les présidentielles, les « Verts » préconisent une sortie du nucléaire d’ici 2030, quant à François Hollande s’il est favorable à une baisse de la part de la production nucléaire (passer à 50% en 2025), il a refusé d’envisager une sortie du nucléaire à une date précise.
Fixer le mix électrique d’un pays comme la France met en jeu plusieurs paramètres (le problème se pose bien sûr pour d’autres pays comme l’Allemagne par exemple) : la sécurité de la production (éviter des « black outs »), la sûreté des filières (les risques d’accidents en particulier pour le nucléaire), le coût économique de l’électricité, l’importance que l’on accorde à la question climatique. Ces quatre paramètres sont interdépendants ce qui fait toute la difficulté du problème. Dans un pays moderne on peut penser qu’il est crucial d’assurer une production sans intermittence de l’électricité de base (souvent à forte puissance), par exemple pour les transports (chemins de fer, métros, etc., les moteurs d’une rame de TGV consomment de 8 à 10 MW), pour une bonne partie de l’industrie (pour éviter des incidents industriels par exemple des fours, moteurs, etc.), et une petite partie du secteur résidentiel et des services. Sur une consommation finale d’électricité en France en 2010 de 450 TWh (30 TWh dans les transports, 100 TWh dans l’industrie, 300TWh dans les services et le résidentiel) cette électricité de base représente sans doute de 50% de la consommation totale. Or, aujourd’hui, faute de solutions techniques opérationnelles pour le stockage de l’électricité, les énergies renouvelables (éolien et solaire) qui sont intermittentes ne peuvent pas assurer la production de cette électricité de « base ». Dans ces conditions, il faut recourir à l’hydraulique, au nucléaire et aux énergies carbonées (gaz, charbon pour l’essentiel) et peut être à des petites centrales au bois. Observons que ce point important n’est pas discuté dans le scénario négaWatt. Si l’on estime que le réchauffement climatique est une menace sérieuse, il faut alors limiter au maximum les énergies carbonées tout en gardant une marge avec des centrales à gaz pour les pointes. On peut alors retenir l’hypothèse d’une production de cette électricité de base à 75%- 80% par le nucléaire qui a l’avantage de ne pas avoir d’incidence climatique. Cela suppose bien sûr une confiance dans la sûreté de la filière qui de toute façon doit être renforcée après Fukushima. S’agissant de l’autre « quota » d’électricité (50% de la consommation finale), on peut faire l’hypothèse que l’on pourrait répondre à la demande de cette consommation à un niveau de 70- 80% par des renouvelables à l’horizon 2030, sous forme soit centralisée (des fermes éoliennes par exemple) soit décentralisée (des panneaux photovoltaïques sur les maisons), le nucléaire complétant ces filières à hauteur d’environ 20% avec éventuellement du thermique avec de la biomasse. Observons au passage que le paramètre climatique rentre aussi en compte dans le choix d’une filière renouvelable. En effet, si l’éolien n’a pas d’incidence climatique, en revanche, les cellules photovoltaïques en ont une dans la mesure où leur production (via des matériaux comme le silicium) consomme beaucoup d’électricité qui peut être d’origine « carbonée » (comme c’est le cas en Chine). Tous comptes faits, une arithmétique électrique fait ressortir un scénario avec un poids du nucléaire de 45 à 50% vers 2030, très proche du scénario de RTE.
Le paramètre économique rentre évidemment en ligne de compte. Pour l’heure le coût du kWh d’électricité produit par des sources renouvelables est plus élevé que par les filières actuelles (l’hydraulique notamment) : celui de l’éolien est deux fois plus élevé et celui du solaire de 5 à 10 fois. Cependant, il est très probable que le coût du kWh éolien deviendra compétitif dans un délai de 10 ans (on pourra mettre en service des turbines de grande puissance dans une gamme de 5 à 10 MW), mais pour le solaire la rentabilité économique suppose une baisse des coûts de production des cellules et la mise au point d’autre filières que le silicium et avec un rendement plus élevé, ce qui représente un effort de R&D et industriel d’au moins vingt ans. Si le nucléaire est économiquement compétitif, il n’est pas douteux que les exigences de sûreté vont conduire au renchérissement du kWh nucléaire, les alea financiers rencontrés dans la construction de l’EPR (un réacteur dit de troisième génération plus sûr) en Finlande, et à Flamanville par EDF en témoignent. On remarquera que dans les débats actuels, le paramètre de l’« indépendance énergétique du pays » rentre rarement en ligne de compte. S’agissant d’électricité, le nucléaire assure une quasi-indépendance (il est nécessaire d’importer l’uranium mais les sources d’approvisionnement sont relativement diversifiées), le charbon ne pose pas de problème d’approvisionnement mais en revanche le gaz peut en poser car nous ne sommes pas à l’abri de conflits pouvant intervenir dans certaines des régions où la France s’approvisionne (Moyen-Orient, Afrique et Russie) et d’une menace d’une augmentation forte du prix du gaz. Quant aux énergies renouvelables elles assurent une indépendance énergétique quasi-totale (à ceci près que nous importons la grande majorité des cellules photovoltaïques).
On remarquera que la situation française actuelle, 78% de l’électricité fournie par le nucléaire, n’est pas sans risques. En effet, dans l’éventualité d’un accident grave sur une centrale, qui ne saurait être exclu, qui conduirait à arrêter plusieurs réacteurs pour réaliser des tests de sûreté, la France pourrait se trouver privée d’une capacité de production de plusieurs GW qui la conduirait à importer « massivement » de la puissance électrique. C’est une situation à laquelle se trouve aujourd’hui confronté le Japon et qui conduit l’Institut d’économie de l’énergie du Japon à Tokyo (www.eneken.ieej.org.jp ) dans une étude récente (« Lessons from Fukushima ») sur les conséquences de l’accident de Fukushima à s’alarmer de la capacité du système de production japonais à faire face à la demande pendant l’hiver et l’été prochains alors que la quasi-totalité des réacteurs seront à l’arrêt pour des tests; le Japon procède d’ores et déjà à des importations massives de gaz pour ses centrales et l’Institut prévoit une forte hausse du kWh l’an prochain (+ 18% pour les ménages et +36 % pour les entreprises).
Le chiffrage financier des scénarios est un exercice nécessaire mais difficile car il suppose que l’on fasse d’abord une hypothèse sur l’évolution de la demande. Les scénarios tendanciels font l’hypothèse d’une croissance annuelle moyenne de 1% de la demande, alors que négaWatt suppose une chute très forte grâce à des économies très importantes notamment dans le secteur résidentiel. Compte tenu des aléas pesant sur les énergies renouvelables, les scénarios supposant une forte chute de la part du nucléaire requièrent un effort de compression de la demande. Les scénarios fondés soit sur l’hypothèse d’une sortie du nucléaire soit d’une baisse forte de sa part (un scénario à 45-50% par exemple) sont difficiles à chiffrer car si un réacteur nucléaire de 1 GW débite de l’électricité pendant 80% du temps en moyenne, il n’en va pas de même pour des éoliennes et des centrales solaires et l’on ne substitue donc pas strictement 1 GW nucléaire par 1 GW renouvelable, le coût de ces scénario va donc dépendre du mix énergétique choisi (il ne sera pas le même pour l’éolien et le solaire). Dans une interview au Figaro (le 22 septembre), l’Administrateur général du CEA, Bernard Bigot, chiffrait à 750 milliards d’euros le coût pour la France de la sortie du nucléaire. En fait ce chiffre est une extrapolation des investissements que prévoit l’Allemagne, 250 milliards d’euros, pour remplacer sa capacité de production d’électricité nucléaire et construire des nouveaux réseaux, la puissance nucléaire installée de l’Allemagne étant trois fois plus faible que celle de la France, une sortie française du nucléaire coûterait trois fois plus cher…Cette extrapolation du CEA n’est pas fondée.
En fin de comptes peut-on sortir du nucléaire ? A horizon de vingt ans les risques que ferait courir une sortie du nucléaire à l’approvisionnement électrique de la France seraient sans aucun doute considérables. En revanche, il est raisonnable d’entreprendre une transition énergétique avec l’objectif de baisser très significativement la part du nucléaire en investissant dans les énergies renouvelables et le thermique utilisant la biomasse. A l’horizon 2035 il sera nécessaire de faire le point sur l’avenir du nucléaire : – de nouvelles filières pourront-elles prendre le relai (par exemple utilisant le plutonium dans des surgénérateurs) ? – aura-t-on trouvé le moyen de se débarrasser des déchets à vie longue ? Si l’on n’a pas de réponses satisfaisantes à ces questions alors l’avenir du nucléaire risquera d’être fermé. Ajoutons que tous les scénarios qui supposent une forte augmentation de la part des énergies renouvelables ne sont crédibles que si l’on amplifie l’effort de recherche sur ces filières, sur le stockage de l’électricité et les réseaux électriques et l’on favorise l’émergence d’entreprises capables de le valoriser ce que la France n’a pas su faire jusqu’à présent.