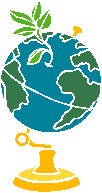 Après le demi-échec de la conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague, en décembre 2009, on attendait avec prudence et circonspection les résultats de la nouvelle conférence sur le climat qui s’est tenue à Cancun, au Mexique, et qui s’est achevée le 11 décembre. Après de très longs débats, un mémorandum préparé sous la houlette de la présidence mexicaine de la conférence, a été adopté et celui-ci témoigne que des progrès sont peu à peu réalisés sur la voie d’un accord international sur le climat même s’il reste encore un long chemin à parcourir.
Après le demi-échec de la conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague, en décembre 2009, on attendait avec prudence et circonspection les résultats de la nouvelle conférence sur le climat qui s’est tenue à Cancun, au Mexique, et qui s’est achevée le 11 décembre. Après de très longs débats, un mémorandum préparé sous la houlette de la présidence mexicaine de la conférence, a été adopté et celui-ci témoigne que des progrès sont peu à peu réalisés sur la voie d’un accord international sur le climat même s’il reste encore un long chemin à parcourir.
La conférence sur le climat organisée par l’ONU à Cancun a rassemblé sous la présidence du Mexique pendant deux semaines les représentants des pays qui sont parties prenantes à la convention de l’ONU sur le climat. Après des conférences préparatoires tenues au cours de l’année, notamment à Tianjin, les craintes étaient fortes que cette nouvelle étape de la négociation qui doit conduire notamment à une prolongation du protocole de Kyoto ne débouche sur un échec, d’autant plus que le Japon avait annoncé qu’il n’envisageait pas de signer un accord post-Kyoto et que les USA et la Chine s’opposaient sur presque tout. En fait si l’on ne peut pas parler d’un grand succès, Cancun a enregistré des progrès substantiels et réels sur la voie d’un « accord », ce demi-succès doit beaucoup à l’obstination diplomatique de la présidence mexicaine de la conférence et en particulier à la ministre des affaires étrangères du Mexique Patricia Espinosa qui a d’ailleurs été ovationnée à la fin de la conférence. Un mémorandum final d’une trentaine de pages a été adopté à l’unanimité (seule la Bolivie ne s’y est pas associée). Le progrès le plus marquant et très positif enregistré à Cancun est le rôle central que les pays en développement ont accepté de jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Rappelons d’abord les points principaux du texte adopté non sans mal à Copenhague (3 pages en 12 points) et qui était une déclaration de principe sans engagement contraignant : – il fixe l’objectif de maintenir en dessous de 2° C l’élévation de la température moyenne de la planète depuis son niveau atteint au début de l’ère industrielle – les Etats industriels parties prenantes au protocole de Kyoto devaient faire connaître, début 2010, leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020, pour aller au delà des objectifs fixés par ce protocole, et les pays en développement les mesures qu’ils comptent adopter pour diminuer les leurs – les pays industriels s’engagent à mettre en place un Fonds de 30 milliards de $ sur la période 2010- 2012 pour aider les pays en développement à pallier l’impact du changement climatique et qui devrait atteindre 100 milliards de $ par an à partir de 2020, ces financements alimenteront un Fonds « vert » pour le climat. L’importance de la lutte contre la déforestation était également reconnue comme un moyen de préserver le climat et les pays en développement devraient recevoir une aide financière pour préserver leurs forêts.
Le mémorandum de Cancun reprend à son compte tous les objectifs de Copenhague et constate que pratiquement tous les pays ont fait part de dispositions concrètes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et en particulier de CO2. Beaucoup d’experts constatent, il est vrai, que les objectifs de réduction annoncés ne permettront sans doute pas d’atteindre l’objectif de limiter à 2°C l’augmentation de la température de l’atmosphère de la planète. Plusieurs points importants confortent l’accord de Copenhague et même le renforcent. Le premier est que les pays développés tout comme les pays en développement (la Chine en particulier qui s’y était jusqu’alors opposée) acceptent le principe de rendre périodiquement des comptes sur leur plans de lutte contre le réchauffement climatique, il sera procédé à une évaluation internationale des progrès de la réalisation des engagements (une première évaluation sera réalisée sur la période 2013-2015). L’accord de Cancun reconnaît l’importance d’un mécanisme de soutien à la lutte contre la déforestation par les pays en développement (les forêts tropicales étant des puits de carbone). Ce mécanisme baptisé REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) sera mis en place avec un soutien financier et technique des pays développés. La création d’un « Fonds vert climatique» pour des programmes destinés à aider les pays en développement menacés par le changement climatique à travers des programmes d’adaptation et des transferts de technologie pour adopter des techniques énergétiques non carbonées (en particulier les filières d’énergie renouvelable) est par ailleurs confirmée. Il sera constitué en deux étapes : – d’ici 2012 un fonds de 30 milliards de $ – après 2020 un financement annuel de 100 milliards de $ pour le « Fonds vert climatique » abondé par les pays développés. Un gestionnaire du fonds (trustee) sera désigné, la Banque Mondiale devant jouer ce rôle transitoirement. Enfin l’accord de Cancun prévoit la création d’un centre international de technologie pour étudier les questions de changement climatique et les technologies énergétiques liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Le mémorandum de Cancun reconnaît également l’intérêt des mécanismes de développement propre (des achats de quota de CO2 par les pays développés auprès de pays en développement en échange d’investissements dans les énergies « propres ») prévus par le protocole de Kyoto. Quant à la reconduction de ce dernier qui vient à échéance en 2012, et qui était une pomme de discorde, la question est renvoyée à une autre conférence qui doit se tenir à la fin de l’année 2011 à Durban en Afrique du Sud …
Le mini accord de Cancun permet de poursuivre sur de bonnes bases la négociation climatique et c’est en cela qu’il est positif. S’agissant d’énergie nous avons vu à plusieurs reprises que le scénario de Copenhague (limiter à 2°C le réchauffement climatique) correspondant au scénario « 450 » (une concentration de 450 parties par million en équivalent CO2) proposé par l’AIE et réactualisé en novembre dernier, imposait de très fortes contraintes à la demande modiale d’énergie primaire : la part des énergies carbonées (aujourd’hui 80%) devrait passer à 63% d’ici 2035. Cela suppose un effort économique et technologique considérable et ce d’autant plus que les experts prévoient que la demande d’énergie des pays en développement doit continuer à croître alors que la plupart d’entre eux (notamment les pays africains) sont loin de posséder les technologies à bas carbone. Ce constat met en évidence une fois de plus la nécessité de politiques de transferts de technologies en direction de ces pays ainsi que de formation de techniciens et d’ingénieurs qui sont un point clé d’un futur accord. Le mémorandum de Cancun prend d’ailleurs en compte ces impératifs au niveau de la recherche, du développement technique et de la formation. Il rester à le concrétiser et à remplir la caisse du « Fonds vert »… Il y a encore du chemin à parcourir de Cancun à Durban et peut être au delà.