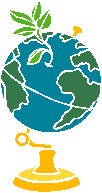 La période d’été qui s’achève a été fertile en décisions, événements et débats sur les questions énergétiques. Ainsi le programme Iter sur la fusion thermonucléaire a t-il été recadré, la marée noire causée dans le golfe du Mexique par l’explosion de la plateforme off-shore de BP a été maîtrisée, tandis qu’en France les conditions de financement des installations de production d’électricité photovoltaïque étaient revues et débattues. Il y là matière à réflexion sur l’avenir des grands filières énergétiques en France et dans le monde.
La période d’été qui s’achève a été fertile en décisions, événements et débats sur les questions énergétiques. Ainsi le programme Iter sur la fusion thermonucléaire a t-il été recadré, la marée noire causée dans le golfe du Mexique par l’explosion de la plateforme off-shore de BP a été maîtrisée, tandis qu’en France les conditions de financement des installations de production d’électricité photovoltaïque étaient revues et débattues. Il y là matière à réflexion sur l’avenir des grands filières énergétiques en France et dans le monde.
Le programme international ITER sur la fusion thermonucléaire est entré dans une zone de turbulence car son coût connaît une escalade impressionnante. Son objectif est de réaliser la fusion par confinement magnétique: on crée un plasma de deutérium et de tritium (des isotopes de l’hydrogène) porté à très haute température (200 millions de degrés) qui est confiné dans une chambre qui a la forme d’un tore, un tokamak, par des champs magnétiques très élevés. L’ampleur des problèmes à résoudre a conduit la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Japon, la Russie, l’Union Européenne et les USA à lancer un programme international sur la fusion Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) lancé officiellement en 2007. Le réacteur expérimental doit être construit en France à Cadarache, dans les Bouches du Rhône, sur un site du CEA ; les travaux de génie civil pour aménager le site sont terminés et la construction d’Iter devrait donc commencer. Alors que le coût de la machine avait été estimé à 5 milliards d’euros en 2006, des éléments nouveaux sont survenus (cf. notre brève précédente). En effet, un grand nombre de modifications au schéma initial ont été recommandées, en particulier pour les dispositifs de chauffage du plasma et sa stabilisation (pour éviter les turbulences) et pour extraire de l’enceinte le combustible usagé; il est aussi nécessaire d’éviter que des bouffées explosives d’énergie lors de la fusion ne détériorent les parois de l’enceinte. La hausse du prix des matières premières a aussi poussé vers le haut le coût de construction de la machine qui atteindrait aujourd’hui 15 milliards d’euros au minimum soit près du triple du devis initial. Un Conseil extraordinaire d’Iter qui s’est tenu en juillet à Cadarache a entériné le nouveau budget pour le tokamak (sur la base de ce coût "approximatif") avec un scénario par étapes : le premier plasma devrait être obtenu en 2019, soit avec près de 3 ans de retard, et les expériences avec le deutérium et le tritium ne seraient lancées qu’en 2028. L’addition est salée pour l’UE qui finance 45% du programme, elle devra ajouter 1,4 milliard d’euros à sa contribution, qui seront redéployés de fonds du Programme-cadre pour la recherche et d’autres programmes. Il est difficile d’apprécier si ce budget sera tenu mais de fortes critiques sont portées contre Iter, en particulier par le physicien G. Charpak, prix Nobel de physique, qui estime qu’il est un pari scientifique inutile qui prive de moyens d’autres secteurs de la recherche.
La marée noire provoquée par l’explosion de la plateforme Deep Horizon de BP, en avril dernier, sur un champ de pétrole off-shore dans le golfe du Mexique a continué à défrayer la chronique pendant l’été. Les opérateurs du puits de pétrole (se trouvant à 1500 mètres de profondeur) ne sont parvenus à arrêter la fuite de pétrole qu’en août en bouchant le puits. Les dégâts provoqués par la marée noire sont certainement importants puisqu’une partie de la marée noire a atteint les côtes de Louisiane et de Floride, en particulier dans des zones marécageuses, mais le comportement de la nappe de pétrole qui s’est formée entre deux eaux reste mystérieux (5 millions de barils de pétrole au total se sont échappés du puits) ; des observations effectuées en août indiqueraient qu’elle aurait disparu sans que l’on sache ce qu’elle est devenue. Le pétrolier BP responsable de la catastrophe qui a fait 11 victimes, a publié un rapport, en septembre, sur les causes de la catastrophe (www.bp.com ). Ce rapport interne réalisé avec la participation d’experts extérieurs conclut que l’accident résulte de l’enchaînement de failles techniques et d’erreurs humaines, et il en a relevé pas moins de huit. La première qui a déclenché la chaîne d’événements est la mauvaise qualité du ciment utilisé par un sous-traitant américain, Halliburton, pour le chemisage des parois du puits, ce ciment était poreux et il n’a pas empêché le pétrole et le gaz du gisement de remonter à la surface par l’enveloppe du puits. L’enquête reconnaît également que les tests de pression par Transocéan (la société suisse propriétaire de la plateforme) et BP ont été réalisés trop rapidement, l’intégrité du puits n’avait donc pas été suffisamment bien établie. Il semble que les opérateurs de la plateforme aient tardé à faire le bon diagnostic lorsque s’est produite une infiltration anormale de pétrole et de gaz qui sont remontés vers la surface et ce flux a été détourné par erreur vers un séparateur de gaz et de boue au lieu d’être déversé dans la mer, le gaz a ensuite envahi la plateforme provoquant une explosion dans la salle des machines. Les enquêteurs ont enfin observé qu’alors que la plateforme était privée d’alimentation électrique à la suite de l’incendie, les batteries électriques de secours étaient insuffisamment chargées et la fermeture des vannes sur le puits était alors impossible… A travers ce rapport BP charge évidemment des sous-traitants mais reconnaît ses responsabilités globales et les carences de ses procédures de contrôle.
Le démarrage de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, en particulier par la filière photovoltaïque, est très lent en France même si son rythme s’est accéléré: la puissance installée est aujourd’hui d’environ 500 MW. Cette accélération (constatée aussi en Espagne et en Allemagne) doit beaucoup aux mesures d’incitation fiscale favorables aux énergies renouvelables et au tarif de rachat par EDF très avantageux des kWh produits (le coût de production de l’électricité photovoltaïque est 3,5 fois supérieur à celui de l’hydroélectricité et le prix de rachat pour la production par des panneaux sur des bâtiments dix fois plus élevé que le prix de vente d’électricité sur le marché, ce qui représente un surcoût de 2 milliards d’euros en 2010). Face à l’inflation des demandes de raccordement au réseau des installations, le gouvernement a demandé à une commission de l’Inspection générale des finances, présidée par J-M. Charpin, d’étudier la question de l’énergie solaire photovoltaïque. Les conclusions du rapport, publié début septembre, sont assez tranchées. Si celui-ci reconnaît l’intérêt de la filière pour la France, il estime cependant qu’il ne « faut pas en faire trop » aujourd’hui et que l’emballement actuel est très coûteux pour l’Etat, de plus le matériel étant en majorité importé, ces importations creusent le déficit commercial de la France. Le rapport estime que le rythme actuel n’est pas tenable car au lieu de l’objectif de 5,4 GW installés en 2020 fixé par le Grenelle de l’environnement, on atteindrait près de 17 GW en 2020 ce qui imposerait une charge financière très importante à EDF (un coût de 4,5 milliards annuels à partir de 2020). Il recommande donc une cible annuelle d’installation de 300 à 500 MW ainsi qu’une baisse des tarifs de rachat ; il souligne aussi l’importance de la R&D dans ce domaine. Le gouvernement a d’ores et déjà décidé de diminuer les avantages fiscaux pour la filière (une baisse de moitié du crédit d’impôt pour les investissements des particuliers) et une baisse des tarifs de rachat de l’électricité pour les futures installations de 17 à 30%.
Quelles conclusions peut-on tirer de ces trois « événements » touchant trois filières différentes ? La première est que l’énergie représente pour toutes les filières des investissements très importants (l’accident du golfe du Mexique aura des coûts indirects très élevés) qui ne s’amortissent que sur une longue durée, la recherche étant elle-même coûteuse comme le montre Iter. Il est donc vain d’attendre un décollage rapide d’une nouvelle filière. La montée en puissance d’une nouvelle filière comme le photovoltaïque suppose qu’une industrie se mette en place (et la France accuse un retard certain dans ce domaine) mais aussi que la recherche permette d’ouvrir des voies nouvelles (il n’est pas « écrit » que c’est la filière au silicium qui s’imposera à log terme), un « rush » technologique n’est donc pas forcément justifié. S’agissant de projets lourds comme la fusion et le pétrole off-shore, il est trivial d’insister sur l’importance des technologies de pointe dans ces domaines. L’exploitation du pétrole off-shore par grands fonds (plus de 1500 m) nécessite le recours à des automatismes, de la robotique et des systèmes de contrôle de plus en plus performants avec des conditions draconiennes de sécurité des installations. Quant à Iter il pose une question de fond : quelle doit être la place des « paris » scientifiques à long terme ? La fusion ne sera une solution, si toutefois elle en est une, qu’au delà de 2050, or on doit faire des choix et préparer des solutions pour l’énergie dans les 20 ans qui viennent. Il est donc nécessaire de mobiliser la recherche sur les solutions à moyen terme notamment la IV e génération du nucléaire, la filière des surgénérateurs. Il serait donc sage de ne lancer les programmes de fusion qu’à un stade exploratoire et si les perspectives du coût d’Iter devaient encore grimper dans les deux années à venir (ce que l’on ne doit pas exclure), il serait alors nécessaire de remettre le programme à plat.
Au-delà du problème français, on doit s’interroger sur les perspectives technologiques du secteur de l’énergie et c’est ce que vient de faire l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport (désormais annuel) « Energy Technology Perspectives 2010 » (www.iea.org ) qui passe en revue les techniques clés susceptibles de contribuer à la solution des problèmes énergétiques de la planète. Ce rapport part du constat que les émissions actuelles de gaz à effet de serre croissent au même rythme que celui de la demande d’énergie qui, pour l’heure, est à 80% carbonée (84% des émissions de CO2 sont liées à la consommation d’énergie) : la croissance de la demande d’énergie se poursuivant (mais elle a reculé 2009), il est vain d’espérer limiter à 2°C l’augmentation de la température de la planète d’ici la fin du siècle. Aussi l’AIE propose-t-elle dans son rapport un scénario énergétique, Blue Map, qui serait compatible avec cet objectif : il ne prévoit qu’une croissance d’un tiers de la consommation mondiale d’énergie entre 2007 et 2050 au lieu de 80% pour son scénario Business as usual . Ce scénario alternatif suppose la mobilisation de tout un arsenal de techniques: la production d’électricité, les réseaux électriques, l’industrie, l’habitat et le transport. Le secteur de la production d’électricité est sans doute celui où les efforts techniques les plus importants devront être réalisés : il s’agit de remplacer le charbon dans l’alimentation des centrales, de lancer le stockage souterrain du CO2 émis par celles-ci, de développer les énergies renouvelables mais aussi le nucléaire dont la part devrait doubler d’ici 2050 (la IV e génération du nucléaire devrait être au point vers 2040-2050). Les efforts de mise au point des réseaux électriques « intelligents » (smart grid) devraient accompagner ceux sur les techniques de production. Si les techniques sont pratiquement mûres dans le secteur du bâtiment pour y réaliser des économies d’énergie, il n’en va pas de même dans le transport. L’utilisation d’une motorisation électrique est une voie possible mais elle suppose des progrès importants des batteries. La pile à combustible est une deuxième option, elle suppose aussi des progrès techniques, les biocarburants en est une troisième.
Les difficultés rencontrées cette année par plusieurs filières et le rapport de l’AIE montrent que l’effort de financement mondial nécessaire à tous les développements techniques sera considérable : d’ici 2050 un scénario tel que Blue map devrait mobiliser au total 316 000 milliards de $, avec un effort important qui devrait être réalisé dans les transports. Un effort de R&D considérable devrait accompagner les politiques énergétiques avec des transferts de technologie en direction des pays en développement. Tout cela appelle aussi un effort de prospective sur les politiques énergétiques qui demeure insuffisant.