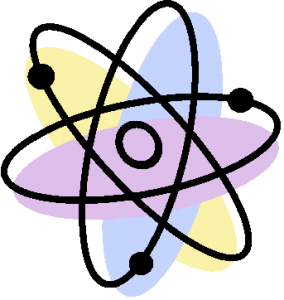 La lutte contre le réchauffement climatique et les besoins en énergie des pays en développement ont ouvert de nouvelles perspectives à l’énergie nucléaire. Toutefois, les risques de diffusion des techniques nucléaires à des fins militaires restent toujours d’actualité et la nécessité d’une application stricte du Traité de non prolifération nucléaire a été réaffirmée lors d’une conférence de l’ONU en mai dernier qui est considérée comme un succès. Il est donc opportun de faire le point sur cette importante question.
La lutte contre le réchauffement climatique et les besoins en énergie des pays en développement ont ouvert de nouvelles perspectives à l’énergie nucléaire. Toutefois, les risques de diffusion des techniques nucléaires à des fins militaires restent toujours d’actualité et la nécessité d’une application stricte du Traité de non prolifération nucléaire a été réaffirmée lors d’une conférence de l’ONU en mai dernier qui est considérée comme un succès. Il est donc opportun de faire le point sur cette importante question.
Les besoins en énergie des pays en développement qui demeurent importants ainsi que la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre (en particulier le CO2) qui sont la cause principale du réchauffement climatique ont relancé les projets de construction de centrales nucléaires. Or le nucléaire n’est pas une énergie « comme les autres » dans la mesure où elle repose sur des techniques qui ont une application civile et militaire, sa relance remet à l’ordre du jour la question difficile mais incontournable de la non-prolifération nucléaire. Il y a d’abord un débat sur la nécessité de relance du nucléaire qui semble acquise. A la fin de l’année 2009 on recensait ainsi 56 nouvelles centrales en construction dans 14 pays, la Chine ayant le programme le plus important avec 20 unités en cours de construction, ces chantiers vont accroître de 50 GW les capacités mondiales de production d’électricité (les capacités mondiales actuelles s’élevant à 374 GW). On observera que si les scénarios énergétiques du type « Business as usual » (on laisse se poursuivre les tendances actuelles) ne prévoient pas une augmentation de la part du nucléaire dans la production d’électricité (14% aujourd’hui) ceux-ci ne sont pas considérés comme « soutenables » car ils prévoient une multiplication par un facteur de 2,5 de la production mondiale d’électricité d’ici 2050 assurée au 2/3 par des combustibles fossiles (cf. AIE, Energy Technology Perspectives 2010, www.iea.org ). Ce scénario n’est évidemment pas compatible avec une lutte contre le réchauffement climatique qui suppose une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le scénario dit Blue Map de l’Agence Internationale de l’Energie qui serait compatible avec une limitation à 2°C du réchauffement de la planète suppose, quant à lui, une limitation drastique des émissions de CO2 en particulier par les centrales électriques et donc une « décarbonisation » massive de cette production qui implique, notamment, un recours important au nucléaire. Selon Blue Map, le nucléaire pourrait représenter 24% de la production d’électricité en 2050 soit une puissance installée de 1200 GW ce qui nécessiterait la mise en service de 30 unités de 1 GW par an d’ici 2050. Ce scénario n’est peut être pas réaliste ou réalisable mais il a le mérite de montrer que l’on évitera difficilement une remontée en puissance du nucléaire.
Cette remontée en puissance du nucléaire n’est évidemment pas sans problèmes. Elle suppose la mobilisation importante de capitaux (le nucléaire demande beaucoup de capitaux) et la solution de problèmes techniques (la mise en route de la troisième génération de réacteurs, celle de l’EPR lancé par Areva notamment, un traitement des déchets et leur stockage) mais aussi une application stricte des règles de sécurité et un contrôle international de l’utilisation des matériaux fissiles c’est-à-dire de l’uranium et du plutonium. Si le développement du nucléaire a une dimension géopolitique c’est parce que les combustibles nucléaires (l’uranium et le plutonium qui est produit dans un réacteur) peuvent être utilisés pour fabriquer une arme nucléaire. C’est l’enjeu du débat sur la non-prolifération nucléaire c’est-à-dire le contrôle des matériaux fissiles que nous avons abordé à plusieurs reprises. Le Traité de Non Prolifération Nucléaire (NPT), signé en 1968, a été une étape importante dans la marche vers un désarmement nucléaire qui est loin d’être réalisé. Rappelons que ce traité signé par les cinq puissances qui détenaient l’arme nucléaire au moment de sa signature (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : USA, URSS, Chine, France, Royaume-Uni) prévoit que les signataires, hormis les cinq détenteurs de l’arme nucléaire, s’engagent à ne pas se doter d’armes nucléaires ; en contrepartie elles pourront recevoir une aide pour leurs activités civiles pour développer l’énergie nucléaire qui devront être contrôlées par l’Agence Internationale de l’Energie Nucléaire de Vienne. On notera que le dernier article du TNP engageait les cinq pays détenteur de la bombe atomique à procéder à un désarmement nucléaire … à long terme, clause… qui n’a pas encore été respectée bien que les USA et l’URSS aient récemment signé un accord prévoyant une diminution importante de leurs armes nucléaires stratégiques (c’est-à-dire portées par des missiles). L’Inde, le Pakistan et Israël n’ont pas signé le TNP et se sont dotés de l’arme nucléaire, l’Iran l’a signé mais l’on sait que ses intentions de développer un nucléaire à des fins pacifiques sont mises en doute alors que ce pays poursuit un important programme d’enrichissement de l’uranium. Quant à la Corée du Nord, elle se livre à un jeu de palinodies : elle a signé le traité, s’en est retirée pour procéder à un essai d’arme nucléaire (une bombe au plutonium en octobre 2006) pour déclarer ensuite qu’elle renonçait à son programme nucléaire … et – semble-t-il – le reprendre.
Le TNP a un grand mérite : celui d’exister…. C’est sans doute la principale conclusion de la conférence d’examen du traité organisée par l’ONU en mai dernier à New York. Cette conférence à laquelle ont participé 172 pays a été considérée unanimement comme un succès. Dans une déclaration finale d’une quarantaine de pages les participants, les signataires du traité, ont réaffirmé la nécessité d’appliquer strictement toutes ses clauses (y compris un désarmement nucléaire total) afin d’éviter une prolifération militaire du nucléaire qui est une menace à la sécurité mondiale. La déclaration rappelle les obligations des signataires et leur droit à poursuivre leurs activités à finalité civile pour développer l’énergie nucléaire ainsi que la possibilité de pouvoir bénéficier d’une aide internationale. Elle appelle aussi les signataires du traité d’interdiction des essais nucléaires à le ratifier (la France l’a ratifié mais pas les USA, qui cependant l’appliquent, pas plus que la Chine d’ailleurs). Plusieurs recommandations visent à renforcer les pouvoirs et les moyens de l’AIEA de Vienne. Celle-ci devrait pouvoir réaliser des contrôles impromptus de sites nucléaires (comme le prévoit un protocole additionnel au TNP que n’a pas signé l’Iran par exemple) et aussi bénéficier de moyens techniques et financiers pour amplifier ses missions. Si la conférence ne propose pas de mettre en place une « banque » internationale de matériaux fissiles pour alimenter les centrales nucléaires en combustible, elle prend acte de la décision annoncée par la Russie, en 2009, de mettre à disposition l’uranium produit par l’une de ses usines, moyennant un contrôle des pays qui souhaiteraient l’utiliser dans leurs centrales, et elle recommande que la mise en place d’un système de mutualisation des matériaux fissiles à des fins civiles soit étudiée. Enfin, et c’est la partie la plus politique de la déclaration finale de cette conférence d’examen, les participants ont demandé à l’ONU d’organiser une conférence internationale afin d’éliminer les armes de destruction massives, et notamment nucléaires, du Moyen-Orient, une mesure qui vise Israël (qui est invité à signer le TNP) ….et l’Iran qui n’a pas pu s’opposer à l’approbation de la déclaration finale. Si le TNP sort conforté de la récente conférence onusienne, il reste évidemment à renforcer les modalités de son application car le développement de l’énergie nucléaire doit se faire dans des conditions strictes de sécurité : éviter les accidents (ce qui suppose une « culture » de la sécurité qui est loin d’être répandue) et les usages militaires.
Les contrôles prévus par le TNP supposent un perfectionnement continu des techniques de suivi des matériaux fissiles afin d’éviter des retraits clandestins des réacteurs ou d’installations médicales dans des hôpitaux par exemple. Les techniques de surveillance font des progrès constants. Dans un réacteur il faut quantifier la quantité de plutonium qui a été produite par la fission et qui se trouve dans les barreaux d’uranium stockés dans une piscine (ils émettent un rayonnement bleu dit de Cerenkov), on peut le faire en bombardant les barreaux avec des neutrons qui vont induire la fission du plutonium et des émissions de nouveaux neutrons qu’il suffit de mesurer pour estimer la quantité de plutonium (cf. Y. Bhattacharjee « An unending mission to contain the stuff of nuclear nightmares » , Science, vol. 238, p. 1222, 4 June 2010 www.sciencemag.org ). On peut aussi scanner en permanence avec des lasers les salles des installations et comparer des enregistrements périodiques pour mettre en évidence d’éventuels changements des dispositions qui seraient la trace d’opérations suspectes et non déclarées. Enfin une préoccupation majeure et d’éviter des vols par des terroristes qui pourraient fabriquer une bombe « sale » (un explosif chimique projetant des déchets nucléaires). Il faut donc prévoir des mesures très strictes de garde et de confinement de déchets nucléaires notamment dans les hôpitaux.
La volonté de renforcer le TNP manifestée à New York est encourageante, elle doit s’accompagner de mesures concrètes pour renforcer le pouvoir de contrôle de l’AIEA. Les pays qui comme la France souhaitent exporter leur techniques nucléaires doivent non seulement respecter le TNP mais aussi veiller à la mise en œuvre de mesures strictes de sécurité dans les pays se dotant de centrales ce qui ne peut se faire en un tournemain. On observera, au passage que les accords de coopération nucléaire signés récemment par les USA et le France avec l’Inde pour aider ce pays non signataire du TNP à développer son nucléaire civil n’allaient pas dans le bon sens car ils décrédibilisent quelque peu les mesures du traité. Quoi qu’il en soit, si le nucléaire est sans doute dans une nouvelle phase de son développement, on n’évitera pas un débat de fond sur les conditions internationales de ce développement car il a une inévitable dimension géopolitique.