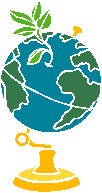 L’Europe était parvenue, en 2008, à élaborer une stratégie énergétique relativement volontariste en se fixant, notamment, des objectifs ambitieux de limitation de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle n’a malheureusement pas su valoriser cette stratégie pour peser dans la négociation sur le climat lors de la conférence de Copenhague en décembre dernier qui n’a pas pu aboutir à des mesures concrètes. Aussi est-il intéressant d’examiner comment l’Europe envisage son avenir énergétique à travers le rapport « Europe 2020 » que vient de publier la Commission Européenne.
L’Europe était parvenue, en 2008, à élaborer une stratégie énergétique relativement volontariste en se fixant, notamment, des objectifs ambitieux de limitation de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle n’a malheureusement pas su valoriser cette stratégie pour peser dans la négociation sur le climat lors de la conférence de Copenhague en décembre dernier qui n’a pas pu aboutir à des mesures concrètes. Aussi est-il intéressant d’examiner comment l’Europe envisage son avenir énergétique à travers le rapport « Europe 2020 » que vient de publier la Commission Européenne.
La question énergétique a toujours été au cœur de la construction européenne. En effet, dés 1951, en Créant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), les six pays fondateurs de l’ « Europe » affichaient leur volonté de reconstruire l’économie européenne sur des bases énergétiques fortes (le charbon dans les années 1950 était encore le vecteur énergétique dominant). Quelques années après, les mêmes six pays craignant pour leur indépendance énergétique (alors que le pétrole du Moyen Orient montait en puissance, la crise de Suez en 1956 avait laissé planer la menace d’un embargo) misaient sur le développement de l’énergie nucléaire en créant l’Euratom, en 1957, par l’un des deux traités de Rome (le premier créait le Marché Commun). Aujourd’hui, les questions énergétiques ont partiellement changé de nature (le problème de l’indépendance énergétique se posant toujours), l’impact de l’utilisation des combustibles fossiles sur le climat étant devenu une préoccupation majeure. Aussi les 27 Etats membre de l’UE avaient-ils conclu, à Bruxelles en 2008 (lors de la présidence française de l’UE), un accord sur le paquet « énergie-climat » qui fixe des objectifs, relativement ambitieux, à l’Europe d’ici 2020 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le rapport Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (www.europa.eu ), publié début mars par la Commission Européenne dans la perspective d’un prochain sommet européen, se veut un programme mobilisateur pour que l’Europe puisse sortir de la crise avec une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale (c’est ce que signifie ce qualificatif alambiqué d’inclusif).
Le rapport souligne que l’Europe doit agir dans trois domaines : – la compétitivité (d’où l’importance soulignée des investissements dans la recherche et la formation), en particulier dans le domaine des technologies vertes – la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction des émissions de CO2 – la promotion d’une énergie propre et efficace. Les objectifs du paquet « énergie-climat » sont pris en compte dans ce rapport. Rappelons que l’UE a prévu de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990, voire de 30% en cas d’accord international (qui n’est pas intervenu à Copenhague). L’UE prévoit d’atteindre cet objectif en réalisant 20 % d’économie d’énergie par rapport au scénario tendanciel pour sa consommation et en utilisant 10% de biocarburants dans les transports. Elle fera passer à 20% sa part des énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. Il avait été prévu que les constructeurs automobiles réduiraient les émissions de CO2 des véhicules neufs en moyenne de 18% d’ici 2015 afin de les placer sous la barre de 130 g/km. A partir de 2013, les entreprises devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en étant soumises à un mécanisme de quota d’émission, un marché des droits de polluer qui seront vendus aux enchères par les Etats, les secteurs industriels exposés à une concurrence internationale et donc à des risques de délocalisation des usines (l’acier par exemple) bénéficiant de l’attribution de quota gratuits tant qu’aucun accord international ne sera signé. Des secteurs comme l’habitat, les transports et l’agriculture ne seront pas soumis à des quotas mais devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 10% d’ici 2020. Un programme test de stockage souterrain du CO2 devrait être lancé aussi au niveau européen.
S’agissant d’énergie, le rapport « Europe 2020 » relève que si l’UE atteignait ses objectifs elle pourrait économiser 60 milliards d’euros d’importations de gaz et de pétrole à l’horizon 2020 ce qui contribuerait à assurer sa sécurité énergétique. La progression de l’intégration du marché européen de l’énergie pourrait permettre d’accroître le PIB européen de 0,6 à 0,8%. Le rapport affirme également que le simple fait d’atteindre l’objectif visant à utiliser 20% d’énergies renouvelable dans la consommation finale d’énergie permettrait de créer 600 000 emplois nouveaux. Avec l’objectif d’une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique, on créerait des emplois supplémentaires et la CE estime que ce sont au total plus d’un million d’emplois nouveaux qui sont en jeu. Ces prévisions économiques sont toujours approximatives et doivent donc être prises en compte avec circonspection (la « crise » nous a appris à prendre avec des pincettes les « prévisions » des économistes), mais il est très probable qu’une politique mobilisatrice de l’énergie suscitera un effort d’innovation qui devrait se traduire par des investissements industriels, la création ou le développement d’entreprises et donc par la création d’emplois. Le rapport souligne d’ailleurs la nécessité d’innover mais aussi de découpler croissance et consommation d’énergie, un problème qui se pose d’ailleurs à l’échelle mondiale et qui se trouve au cœur de la négociation climatique (si la plupart des pays sont disposés à faire un effort pour diminuer l’intensité énergétique de leur PIB, pratiquement aucun n’admettra le principe d’une décroissance de son économie). Ce rapport a pour objectif de donner en quelque sorte une feuille de route à l’Europe pour sortir de la crise. Il se réfère donc, en termes assez généraux il est vrai, au concept de « politique industrielle » (longtemps remisé aux oubliettes bruxelloises) et aussi il tente de relancer, ou de remettre au goût du jour, la politique de recherche et d’innovation de l’Europe. L’objectif d’investir 3% du PIB dans la R&D est repris avec un appel au secteur industriel pour qu’il investisse davantage dans la recherche et la proposition de mettre au point un nouvel indicateur pour « suivre « l’innovation (cet objectif financier sera vraisemblablement rejeté par les ministres des finances européens qui, on le sait, sont des grands visionnaires…). La Commission préconise tout à la fois l’achèvement de l’Espace européen de la recherche et la création d’une « union pour l’innovation ». C’est dans cette perspective que s’inscrit aussi la proposition de lancer un plan stratégique pour les technologies énergétiques dont les lignes directrices ne sont pas précisées (à l’exception de objectif de « décarboner » les transports).
On ne peut pas reprocher à un rapport de cette nature de rentrer dans le détail d’un programme. Le rapport Europe 2020 a le mérite d’exister et de fixer quelques objectifs à l’Europe avec quelques lignes directrices. Force est de constater, toutefois, que la CE en reste encore à des généralités s’agissant de politique industrielle et n’envisage pas de mise à plat du Programme-cadre pour la recherche qui est devenu un véritable labyrinthe avec un très grand nombre de modes d’action. De même le rapport ne met-il pas suffisamment l’accent sur la nécessité de donner toutes ses dimensions à la politique européenne de l’énergie (scientifique et technique, industrielle, réglementaire et fiscale). L’Europe a besoin d’une opération vérité dans le domaine de l’énergie : quels sont les secteurs « critiques » sur lesquels il faut mettre l’accent (le stockage de l’énergie, par exemple, en est un, l’interconnexion des réseaux mentionnée dans le rapport en est un autre) ? Quelle place les énergies renouvelables peuvent elles réellement prendre ? Quel nucléaire fait-il développer ? Quel place l’Europe peut-elle prendre dans le domaine des biocarburants de deuxième génération (une question importante pour l’Europe qui est une grande puissance agricole et qui mériterait davantage que des déclarations d’intention) ? Alors que l’UE joue un rôle pilote dans le programme international Iter sur la fusion thermonucléaire (un objectif à très long terme), elle ne met en oeuvre aucun programme de grande ampleur dans d’autres domaines de l’énergie (hormis peut être dans le secteur des piles à combustible). De même la question de la sécurité des approvisionnements énergétiques (le gaz par exemple) mérite-t-elle une approche commune. Le rôle que pourraient jouer les commandes publiques pour industrialiser des nouvelles filières énergétiques est également passé sous silence alors que c’est une « technique » qui a fait ses preuves dans le passé.
Le rapport Europe 2020, qui reste d’inspiration très libérale, est une ébauche d’un programme pour tenter de sortir de la crise et préparer l’avenir en particulier dans le domaine de l’énergie, mais on peut regretter que la vision prospective que celui-ci donne de l’Europe soit quelque peu étriquée. Ainsi le rôle que pourrait jouer l’Europe dans les affaires de la planète, pendant une décennie où de nouveaux équilibres mondiaux vont se dessiner au milieu de crises probables (crises sanitaires, alimentaires, etc.), est-il à peine mentionné. La négociation climatique se poursuit après la conférence de Copenhague mais le rapport n’esquisse aucune proposition qui pourrait permettre à l’Europe de jouer un rôle majeur dans cette négociation. De même le rapport est-il muet sur la place des grandes questions énergétiques dans cette négociation climatique alors que l’Europe peut favoriser une politique de transferts de technologie vers les pays du Sud, en particulier vers les pays africains, qui doit les aider à réaliser une transition énergétique. En fin de compte, comme le propose le président de la Commission dans sa préface, il reste à passer à l’action mais alors en espérant que l’Europe élargira son champ de vision notamment dans le domaine de l’énergie.