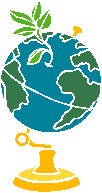 La conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague qui s’est achevée le 19 décembre est considérée comme un quasi échec puisque aucun accord international prévoyant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un calendrier n’a véritablement été adopté par les participants. Si, depuis quelques années, un bon bout de chemin a été parcouru, grâce notamment à la communauté scientifique, dans la prise de conscience de la menace que fait planer sur la planète le changement climatique, l’échec de Copenhague mais aussi l’analyse des contraintes qui pèsent sur les systèmes énergétiques montrent qu’il reste encore du chemin à faire pour s’attaquer au problème.
La conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague qui s’est achevée le 19 décembre est considérée comme un quasi échec puisque aucun accord international prévoyant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un calendrier n’a véritablement été adopté par les participants. Si, depuis quelques années, un bon bout de chemin a été parcouru, grâce notamment à la communauté scientifique, dans la prise de conscience de la menace que fait planer sur la planète le changement climatique, l’échec de Copenhague mais aussi l’analyse des contraintes qui pèsent sur les systèmes énergétiques montrent qu’il reste encore du chemin à faire pour s’attaquer au problème.
La conférence sur le climat organisé par l’ONU a rassemblé pendant deux semaines les représentants de 193 pays à Copenhague sous la présidence du Danemark avec l’objectif de signer un accord pour prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique qui devaient être enregistrées dans un traité ; 120 chefs d’Etat et de gouvernement ont participé à la phase finale d’une négociation qui finalement n’a pas eu lieu. Le texte final élaboré par un groupe restreint de 28 Etats (ceux du G20 auxquels s’étaient adjoints les représentants de continents comme l’Afrique) est un texte de 3 pages en 12 points qui est une déclaration de principe sans engagement contraignant qui n’a pas été approuvé d’ailleurs par l’assemblée des participants à la conférence nombre d’entre eux estimant qu’il n’avait pas été discuté en toute transparence ; cette résolution, un accord à " a minima" , n’a donc pas véritablement de valeur juridique dans le système onusien. Rappelons en les points essentiels : – celle -ci « précise» que l’élévation de la température moyenne de la planète ne devra pas excéder 2° C depuis son niveau atteint au début de l’ère industrielle – d’ici le 31 janvier 2010, les Etats industriels parties prenantes au protocole de Kyoto devront faire connaître leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, pour aller au delà des objectifs fixés par ce protocole, et les pays en développement les mesures qu’ils comptent adopter pour diminuer les leurs – les pays industriels s’engagent à mettre en place un Fonds de 30 milliards de $ sur la période 2010- 2012 pour aider les pays en développement à pallier l’impact du changement climatique (son importance est soulignée pour les pays africains et les Etats insulaires) qui devrait atteindre 100 milliards de $ par an à partir de 2020, ces financements alimenteront un Fonds pour le climat baptisé « Copenhagen Green Climate Fund ». L’importance de la lutte contre la déforestation est également reconnue comme un moyen de préserver le climat et les pays en développement recevront une aide financière pour préserver leurs forêts. Il est enfin prévu de faire le point sur les mesures annoncées en 2015 à la lumière, notamment, du prochain rapport du GIEC et aussi de réaliser des transferts de technologie en direction des pays les plus démunis. En fin de compte, le texte de Copenhague reconnaît le principe important d’une limitation à 2°C du réchauffement climatique, ce qui est important, mais sans prévoir ni calendrier ni outils pour atteindre cet objectif ; il est seulement fait mention d’une nécessité pour les Etats de « coopérer » pour parvenir à un pic des émissions de gaz à effet de serre.
On peut évidemment gloser pour désigner les responsables de cet échec. Il est patent que ni les USA ni la Chine n’ont cherché à faire des concessions pour que la conférence parvienne à un accord trop contraignant même si, avant la conférence, ces deux pays avaient fait montre d’une prise de conscience de l’importance du problème que pose le changement climatique (le texte américain qui prévoit des limitations des émissions américaines n’est pas encore voté par le Congrès ce qui handicapait la position des USA à Copenhague). Quant aux Européens qui ont déjà adopté des mesures importantes (réduction de 20% de leurs émissions en 2020 par rapport à leur niveau de 1990), s’ils étaient disposés à faire davantage à condition que les autres pays s’engagent à fond dans des politiques de réduction, ils n’ont pas su, ou pu, jouer de rôle majeur dans la négociation finale, l’Inde a suivi la Chine, tandis que les pays africains ont plaidé pour que les pays développés adoptent des objectifs plus ambitieux et un plan de soutien financier, les intérêts de pays en développement étant en fin de compte divergents. Il faut ajouter que la Chine (le premier émetteur de CO2 de la planète) n’est pas disposée à accepter des mesures pour contrôler l’efficacité des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre et un régime de sanctions. L’échec de Copenhague révèle d’abord que les intérêts économiques ont primé sur toutes les considérations sur le sort de la planète, les pays participants à la conférence ont certes pris conscience de l’enjeu climatique mais ils ne sont pas disposés à changer leur modèle économique en adoptant des mesures pour « décarboner » leur développement économique forcément coûteuses. Au plan géopolitique, ensuite, la conférence a révélé d’une part les graves faiblesses du système onusien et d’autre part le rôle croissant du duo Chine-USA dans la gouvernance du monde. Il est en effet difficile de négocier un texte qui doit déboucher sur un traité dans une conférence avec près de deux cents délégations (même si au final ce texte doit être signé par toutes parties) et le système de l’ONU se prête mal à une négociation où les parties prenantes délèguent leur pouvoir à un groupe restreint représentant leurs intérêts, le G20 ne pouvant évidemment pas être considéré comme représentatif des pays en développement, il faut trouver un moyen efficace que cet ensemble, en particulier l’Afrique, soit un acteur de la négociation. Quant à la Chine et aux USA, il est clair qu’ils ont pesé de tout leurs poids dans la phase finale de la conférence pour que le texte qui devait être adopté ne contienne aucun engagement contraignant et volontariste sur les émissions de CO2 (à eux deux ces pays émettent près de 45 % du CO2 de la planète). Les intérêts de la Chine et des USA apparaissent comme de fait complémentaires, notamment au plan économique (la Chine détient un part très importante de la dette américaine) et leur développement repose fortement sur l’utilisation des énergies fossiles mais les pays de la planète doivent donc s’interroger sur les risques que fait courir cette gouvernance par un véritable G2…..
Au milieu de ces déconvenues diplomatiques et géopolitiques, la conférence de Copenhague reconnaît la nécessité de limiter à 2°C le réchauffement climatique par rapport à l’époque préindustrielle comme le préconise le GIEC (on observera qu’une augmentation de près de 1°C de cette température est déjà « acquise » et qu’une augmentation de 1.5 °C est quasi certaine….) et les scientifiques et les ONG ont contribué à cette prise de conscience et, après tout, c’est un acquis qui donne une base de travail. Il est patent, toutefois, que si certaines études économiques (notamment celles de N.Stern au Royaume-Uni) ont mis en évidence le fait que l’impact du réchauffement climatique pourrait être élevé pour la planète (environ 5% du PIB mondial annuel), le coût économique et financier de la limitation des émissions de gaz à effet de serre est probablement sous-estimé. Bon nombre de scénarios sur l’évolution de la consommation mondiale d’énergie sont fondés sur une poursuite de la croissance de la demande d’énergie primaire (une augmentation de 40 à 50 % d’ici 2030) avec un maintien du poids des combustibles fossiles (près de 80% de la demande mondiale en 2030). Le rapport annuel de l’AIE (www.aie.org) , le World Energy Outlook 2009, publié avant la conférence de Copenhague estime que les scénarios de forte croissance ne sont pas « durables », aussi consacre-t-il de longs développements à un scénario énergétique qui permettrait d’atténuer le changement climatique, un scénario « post Copenhague », baptisé 450, limitant à 450 ppm (parties par million) la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et compatible avec une augmentation de 2°C de la température terrestre moyenne ce qui requiert une diminution de 50% des émissions mondiales de CO2 d’ici 2050. Cet objectif climatique suppose un scénario de limitation très volontariste de la demande d’énergie : il la limite à 20% en 2030 avec une forte réduction des énergies fossiles dont la part passerait de 80% à 67%. Sa mise en oeuvre suppose, selon l’AIE, une régulation internationale et le développement des énergies renouvelables (y compris les biocarburants) avec une reprise de celui du nucléaire ; la consommation du charbon, en revanche, chuterait de 20% par rapport à son niveau actuel dans ce scénario 450 (le stockage du CO2 devenant une nécessité). Ce scénario, compatible avec « l’accord de Copenhague » requiert un supplément d’investissements cumulés sur la période 2010-2030 de l’ordre de 10 000 milliards $ par rapport au scénario de référence classique (on laisse les choses filer ce qui suppose aussi d’investir pour répondre aux besoins énergétiques), soit 0,5 % du PIB mondial annuel en 2020 et sans doute 1,1% en 2030, dont la moitié serait à la charge des pays de l’OCDE (notamment pour développer les véhicules électriques). Dans les pays en développement, les investissements énergétiques additionnels pour mettre en oeuvre ce scénario sont chiffrés à près de 200 milliards de $ en 2020, ils devraient être en partie financés par des aides des pays les plus développés et des transferts de technologie. En fin de compte, le coût d’un accord sur le climat qui n’a pas été véritablement chiffré est certainement important et les moyens financiers pour réaliser les investissements nécessaires restent à discuter.
Il faut ajouter enfin que l’on sous-estime aussi souvent l’effort technique qu’il faut accomplir et sa durée pour atteindre des objectifs compatibles avec un scénario du type « 450 ». Nous avons insisté à plusieurs reprises sur ce thème dans des brèves. Un article récent dans la revue Nature ( Kramer, G.J., Haigh, M., « No quick switch to low-carbon energy », Nature, vol. 462, p. 568, 3 December 2009) rappelle quelques « lois » du progrès technique en matière d’énergie fondées sur les expériences du vingtième siècle. Quand une technologie est nouvelle elle passe par quelques décennies de croissance exponentielle (c’est le cas de l’éolien et peut être du solaire photovoltaïque aujourd’hui) et elle n’est véritablement considérée comme « mure » que lorsqu’elle contribue à 1% de la production mondiale d’énergie ; ce sera sans doute le cas de l’éolien en 2020 mais l’échéance est plus lointaine pour le solaire et le stockage du CO2 émis par les centrales électriques. On peut faire des considérations assez semblables pour les techniques clés de stockage de l’électricité. Autrement dit, aujourd’hui, en l’absence de ruptures techniques majeures, on ne peut pas attendre de « miracle technique », il faut vivre avec les techniques actuelles en les améliorant (et l’on dispose encore de marges) tout en investissant dans les énergies renouvelables disponibles et sans doute le nucléaire ainsi que dans la recherche pour préparer les ruptures de l’avenir. Les transferts de techniques sont bien entendu un outil de choix pour aider les pays en développement, ils supposent une politique de licences pour les techniques les plus modernes couvertes par des brevets. Mais l’aide des pays les plus riches la plus efficace serait sans doute une contribution à une formation d’ingénieurs et de techniciens et de gestionnaires (dans les services publics et les entreprises) pour maintenir en état les systèmes de production et de distribution de l’énergie et remplacer ceux qui sont les plus polluants notamment en Afrique (ce qui suppose aussi un appui aux « technologies indigènes » comme le propose l’Afrique). Un effort de formation massif devrait être une composante clé d’un futur plan pour lutter contre le réchauffement climatique.
L’après Copenhague sera sans doute difficile, une nouvelle conférence de l’ONU sur le climat étant prévue fin 2010 à Mexico (avec une réunion préliminaire en Allemagne en juin prochain), mais les discours apocalyptiques que l’on entend parfois sur l’avenir climatique du monde sont souvent démobilisateurs. L’énergie est une question clé pour la lutte contre le réchauffement climatique et il faut espérer que tous les acteurs de la négociation qui n’a pas pu déboucher à Copenhague vont parvenir à estimer de façon réaliste, l’année prochaine, les voies et les moyens des stratégies énergétiques permettant certes de consommer moins de carbone, mais qui sont compatibles avec des objectifs de développement. Il faut aussi se persuader à une époque qui privilégie trop le court terme qu’en matière de technologie et de science il faut savoir « donner du temps au temps » si l’on veut vraiment changer la donne ce qui ne veut pas dire pour autant qu’en matière de climat il faille différer les choix……