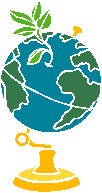 La négociation internationale d’un nouveau protocole sur les émissions de gaz à effet de serre succédant, après 2012, à l’actuel protocole de Kyoto, devrait s’achever en décembre prochain à Copenhague. L’énergie est au cœur du débat car l’objectif central de la négociation est un accord sur des objectifs de réduction de gaz comme le CO2 émis par l’usage croissant des combustibles fossiles. Il est peu probable, dans l’état actuel des choses, qu’un accord puisse être conclu à Copenhague mais il faudrait alors éviter qu’un échec ne compromette les chances d’aboutir à un nouveau protocole avant 2012.
La négociation internationale d’un nouveau protocole sur les émissions de gaz à effet de serre succédant, après 2012, à l’actuel protocole de Kyoto, devrait s’achever en décembre prochain à Copenhague. L’énergie est au cœur du débat car l’objectif central de la négociation est un accord sur des objectifs de réduction de gaz comme le CO2 émis par l’usage croissant des combustibles fossiles. Il est peu probable, dans l’état actuel des choses, qu’un accord puisse être conclu à Copenhague mais il faudrait alors éviter qu’un échec ne compromette les chances d’aboutir à un nouveau protocole avant 2012.
Le système énergétique mondial doit tenir compte de contraintes internationales de plus en plus importantes qui résultent de traités internationaux et en particulier des conventions qui ont pour objectif la lutte contre le réchauffement climatique car les émissions de gaz carbonique (résultat de la déforestation et de l’utilisation des combustibles fossiles) sont un facteur majeur du réchauffement climatique et elles font donc l’objet de conventions internationales qui visent à les limiter. La convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur en 1994, est la première d’entre elles, elle a été suivie par le protocole de Kyoto, entré en vigueur 2005 : il fixe des objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour la période 2008-2012. Les 39 pays développés signataires se sont engagés à réduire globalement de 5,2% le niveau de leurs émissions par rapport à celui de 1990 (les Etats-Unis ne l’ont pas ratifié), les pays en développement sont dispensés d’un effort de réduction car on a estimé que leur décollage économique s’accompagnerait inéluctablement d’une croissance de leur consommation d’énergie. Les Etats se sont vu attribuer des objectifs propres de réduction, les pays de l’UE les répartissant par un accord interne (une réduction de 8%), la France devant ainsi stabiliser ses émissions au niveau de 1990. Le protocole de Kyoto a mis en place un système de « sanctions » pour les pays qui ne respecteraient pas les objectifs qui leur sont fixés mais qui est inapplicable dans la pratique. Il a aussi créé un mécanisme de flexibilité qui permet aux pays en développement de participer à l’effort collectif et qui est baptisé « mécanisme de développement propre », il permet aux pays ou aux entreprises d’acquérir des droits d’émission chez eux en investissant dans un pays en développement pour réaliser des installations industrielles qui permettent de diminuer les émissions locales de gaz à effet de serre (1100 projets de cette nature ont été validés entre 2005 et 2008).
Les objectifs du protocole de Kyoto sont certes modestes mais ils sont un premier pas dans la bonne direction or, au moment où s’engage la négociation, on doit constater que la situation n’est pas satisfaisante. En premier lieu on constate que la plupart des pays industrialisés n’atteindront pas leurs objectifs de réduction de leurs émissions (globalement l’UE atteindra les siens mais grâce à quelques pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni qui ont fait des efforts très importants, d’autres comme l’Italie et l’Espagne étant à la traîne, la Russie quant à elle est en très forte baisse). En second lieu, on observe sur la base des constats des climatologues que le réchauffement de la température moyenne du globe a été de à 0,6°C sur les trois dernières décennies et que des événements climatiques extrêmes (cyclones, inondations, canicules, etc.) tendent à être plus fréquents : on ne serait donc pas sur une tendance permettant de limiter à 2°C le réchauffement climatique par rapport à l’époque préindustrielle comme le préconise le GIEC. A ces constats s’ajoutent le fait que la plupart des scénarios économiques font des projections de forte croissance de la consommation d’énergie (malgré la crise…) et des émissions de CO2 (30 Gtonnes en 2008, 43 Gt en 2030 ?) même si certaines études économiques (notamment celles de N.Stern au Royaume-Uni) mettent en évidence le fait que le coût du réchauffement climatique pourrait être élevé pour la planète (environ 5% du PIB mondial annuel). Ces facteurs ont contribué à une prise de conscience politique que la maîtrise du changement climatique est devenue un problème politique mondial (le changement d’attitude de l’administration Obama aux Etats-Unis est significative de ce point de vue) mais ce n’est pas pour autant que le ciel de Copenhague s’est éclairci.
Malgré une série de conférences préliminaires (à Bali fin 2008, à Bonn en août dernier puis à Bangkok de la fin septembre au 9 octobre), on semble loin d’un accord car les positions des groupes de pays sont encore très éloignées. On perçoit bien qu’un nouveau protocole applicable à partir de 2013 qui aurait pour objectif de limiter à 2°C le réchauffement climatique devra s’appuyer sur trois piliers : – des objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre relativement ambitieux pour les pays développés (dont les USA) pour qu’ils aient un impact tangible sur le climat (une réduction de 80% serait optimale) – des engagements de réduction de la part des pays en développement (notamment de la part de la Chine, de l’Inde et du Brésil) sans doute avec des paliers – des transferts de technologie vers les pays du Tiers Monde pour que ceux-ci améliorent leurs performances énergétiques avec des modes de financement adéquats pour les y aider. L’UE ayant adopté une position en pointe sur la question climatique (elle a prévu de réduire de 20% ses émissions d’ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990 et éventuellement de les porter à 30% en cas d’accord international mais la position des pays grands consommateurs d’énergie d’origine fossile et « grands émetteurs » de CO2 comme les USA et la Chine (40% des émissions mondiales à eux deux) sera évidemment cruciale pour le sort d’un futur protocole. Les positions des ces « grands » sont encore très éloignées car même si celles des USA (la loi sur le climat en discussion au Congrès à Washington ne sera pas votée en décembre ce qui fragilise la position américaine) et de la Chine ont évolué, ces pays restant toutefois très réticents à prendre des engagements « supranationaux » (par exemple dans le cadre de l’ONU). La Chine ainsi que l’Inde et le Brésil ont évidemment beau jeu de montrer que leurs émissions de gaz à effet de serre par habitant sont très en inférieures à celles des pays développés (19 tonnes par habitant aux USA contre 4 tonnes en Chine), il en va de même a fortiori, évidemment, pour les pays africains ; certains pays européens peuvent être aussi montrés du doigt pour leurs mauvaises performances climatiques et leur non-respect du protocole de Kyoto. Par ailleurs, tous les pays en développement exigent, avant de prendre un engagement de réduction, que des aides financières massives soient prévues pour les aider à les tenir avec à la clé des transferts de technologie. Certes les USA, à travers leur plan de relance mettent en oeuvre une politique active de développement des énergies renouvelables et préparent des mesures législatives pour limiter leurs émissions, quant au président chinois, Hu Jintao, il a annoncé dans un discours à l’ONU, fin septembre, que pour la Chine « les intérêts communs du monde entier sont en jeu dans la lutte contre le changement climatique », mais il n’y a pas encore véritablement un « climat » de confiance pour aboutir rapidement à un accord.
Si un accord n’intervenait pas à Copenhague, ce qui est assez probable, peut-on escompter mettre en œuvre « un plan B », autrement dit continuer une négociation internationale sur la base d’un minimum de principes communs acquis à Copenhague ? C’est sans doute possible et c’est ce que propose, notamment, un universitaire américain spécialiste des négociations climatiques dans un article récent (D.Victor, « Plan B for Copenhagen », Nature, vol.461, p. 342, 17 September 2009, www.nature.com ). Celui-ci propose ainsi que les grandes puissances économiques de la planète (le Forum sur l’énergie et le climat des grandes économies ou « club » des 17) entreprennent une négociation parallèle pour poser les bases d’un accord concret. Cette solution a l’avantage de mobiliser les principaux acteurs dont va dépendre un accord final (on retrouve en fait les membres du G20) et la mise en œuvre de mesures concrètes (transferts de technologie et financement) pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette solution a aussi l’inconvénient majeur de marginaliser l’ONU et de laisser en dehors de la négociation la plupart des pays en développement et notamment les pays africains qui seront très touchés par le changement climatique et qui ont pris des positions assez marquées sur le cliùmat par la voix de l’Union Africaine et de l’African Partnership Forum. La voie du réalisme plaide d’une part pour que des plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient lancés avec des objectifs périodiquement vérifiables par la communauté internationale (du type de ceux lancés par l’Europe) avec le renfort d’un marché international du carbone (lié à des permis d’émission de CO2) et d’autre part pour que le « mécanisme de développement propre », supposé être vertueux, soit sérieusement évalué et, à l’avenir, contrôlé dans le cadre d’une nouvelle convention. Un plan B devra aussi trouver un accord sur les transferts de technologie dans les grands domaines énergétiques (du charbon « propre » aux techniques des centrales électriques en passant par le solaire et l’éolien), un effort de formation massif de techniciens et d’ingénieurs pour les pays en développement devrait être une composante clé de ce plan (il passe par le renforcement de leur système universitaire et de recherche) ainsi qu’un appui aux « technologies indigènes » comme le propose l’Afrique (permettant une croissance économique avec une faible émission de CO2). S’agissant du financement, un point de blocage majeur, plusieurs propositions sont sur la table dont une émanant de la Suisse qui propose l’instauration d’une taxe carbone « universelle » (payée par les pays les plus développés) pour financer l’aide aux pays en développement pour parer aux effets du changement climatique et les aider à améliorer leurs performances énergétiques (2$ par tonne de CO2 ce qui représenterait environ 18 milliards de $ par an) via un fonds multilatéral pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Le sort de la réunion de Copenhague n’est pas encore scellé, même si la probabilité qu’un accord puisse être trouvé en décembre est relativement faible, mais l’enjeu pour la planète de la question climatique est tel qu’il faudrait éviter qu’un échec à Copenhague ne condamne toute perspective d’accord avant 2012. L’état actuel de l’économie mondiale n’est certes pas un allié du climat (les plans de relance ciblent en priorité les aides au redémarrage de l’économie et il est probable que les dépenses de recherche et développement seront au mieux en stagnation malgré le discours politique) et les pays industrialisés veulent éviter tout handicap à leur compétitivité mais, à terme, l’émergence d’un marché des nouvelles technologies pour l’énergie peut, en revanche, favoriser les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. La production d’électricité et les carburants pour les transports sont deux domaines où les technologies peuvent accroître les marges de manœuvre pour l’avenir et devraient figurer dans les accords pour les transferts de technologie. Mais un accord sur le climat ne se fera que si les pays de la planète ont une vision commune de l’avenir et au prix de concessions mutuelles. Encore un petit effort mesdames, messieurs les chefs d’Etat et diplomates, ne décevez pas la Petite Sirène….