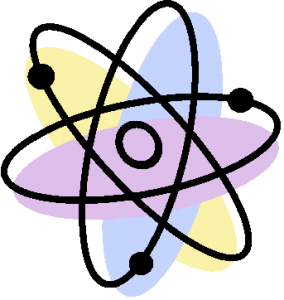 Les besoins en énergie importants des pays en développement, la crainte d’une remontée du cours du baril de pétrole dont les réserves sont limitées, ainsi que la nécessaire limitation des émissions de gaz à effet de serre ont stimulé les investissements en faveur des énergies renouvelables et relancé l’énergie nucléaire. Or, le nucléaire n’est pas une énergie "comme les autres" car elle repose sur des techniques qui ont une application civile et militaire. Sa relance et le débat autour des armes nucléaires ont remis à l’ordre du jour la question difficile mais incontournable de la non-prolifération nucléaire.
Les besoins en énergie importants des pays en développement, la crainte d’une remontée du cours du baril de pétrole dont les réserves sont limitées, ainsi que la nécessaire limitation des émissions de gaz à effet de serre ont stimulé les investissements en faveur des énergies renouvelables et relancé l’énergie nucléaire. Or, le nucléaire n’est pas une énergie "comme les autres" car elle repose sur des techniques qui ont une application civile et militaire. Sa relance et le débat autour des armes nucléaires ont remis à l’ordre du jour la question difficile mais incontournable de la non-prolifération nucléaire.
Le premier réacteur nucléaire (appelé à l’époque pile atomique) a été mis en route en décembre 1942 à l’université de Chicago (sous les gradins du stade de l’université…) par le physicien E.Fermi et son équipe. Cette « expérience » était une étape importante du vaste projet Manhattan lancé par les USA pour construire la bombe atomique qui devait être lancée sur le Japon en août 1945. Depuis lors, la cohabitation entre le nucléaire civil et militaire n’a plus cessée, le développement à grande échelle, dans les années 1950 des applications du nucléaire à la production d’énergie prenant, dans une certaine mesure, le relais des programmes militaires qui se poursuivaient par ailleurs en Europe, en URSS et aux USA. L’énergie nucléaire contribue, aujourd’hui, pour 16% à la production mondiale d’électricité (6% environ de l’énergie primaire totale) dans 439 réacteurs civils et plusieurs scénarios énergétiques tablent sur une croissance de la part du nucléaire dans le panier énergétique. Une quarantaine de réacteurs sont en construction ou en projet dans le monde (dont deux en France). L’avenir du nucléaire dépend donc à la fois de la disponibilité des réserves de minerai d’uranium (ou de thorium) et de la capacité à enrichir l’uranium naturel en isotope 235 qui seul est fissile et utilisable dans la réaction de fission dans un réacteur (le minerai est un mélange des isotopes 235 et 238 de l’uranium mais ne contient que 0,7% de l’isotope 235). Pour les réacteurs on enrichit le futur combustible jusqu’à des teneurs en uranium 235 comprises entre 3 et 4,5% (cf. notre brève sur l’uranium et son enrichissement). Si le développement du nucléaire a une dimension géopolitique c’est parce que les combustibles nucléaires (l’uranium et le plutonium qui est produit dans un réacteur et qui est aussi fissile) peuvent être utilisés pour fabriquer une arme nucléaire. D’où le débat sur la non-prolifération nucléaire c’est-à-dire le contrôle des matériaux fissiles afin qu’ils ne soient pas utilisés pour produire des armes nucléaires.
Qu’en est-il aujourd’hui de cette question complexe à laquelle le président des USA, B.Obama, a consacré un discours important à Prague le 5 avril au cours duquel il a déclaré que les Etats-Unis allaient prendre des « mesures concrètes en faveur d’un monde sans armes nucléaires » ? Rappelons d’abord que la prise de conscience des dangers de l’armement nucléaire a été longue et, en grande partie, l’œuvre de scientifiques et de responsables politiques rassemblés dans le mouvement Pugwash. La Guerre froide n’a évidemment pas facilité les choses mais, néanmoins, le Traité de Non Prolifération Nucléaire (NPT), signé en 1968, a été une étape importante dans la marche vers un désarmement nucléaire qui est loin d’être réalisé. Ce traité signé par les cinq puissances qui détenaient l’arme nucléaire au moment de sa signature (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : USA, URSS, Chine, France, Royaume-Uni) prévoit que les signataires, hormis les cinq détenteurs de l’arme nucléaire, s’engagent à ne pas se doter d’armes nucléaires ; en contrepartie elles pourront recevoir une aide pour leurs activités civiles pour développer l’énergie nucléaire qui devront être contrôlées par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique de Vienne. On notera que le dernier article du TNP engageait les cinq pays détenteurs de la bombe atomique à procéder à un désarmement nucléaire … à long terme, clause… qui n’a pas encore été respectée. L’Inde, le Pakistan et Israël n’ont pas signé le TNP et se sont dotés de l’arme nucléaire, l’Iran, quant à lui, l’a signé mais l’on ses intentions de développer un nucléaire à des fins pacifiques sont mises en doute alors que ce pays poursuit un important programme d’enrichissement de l’uranium. Quant à la Corée du Nord, elle se livre à un jeu de palinodies : elle a signé le traité, s’en est retirée pour procéder à un essai d’arme nucléaire (une bombe au plutonium en octobre 2006) pour déclarer ensuite qu’elle renonçait à son programme nucléaire … et – semble-t-il – le reprendre. On retiendra aussi que la Suède qui s’était vraisemblablement dotée d’armes nucléaires y a renoncé en signant le traité et que l’Afrique du Sud a fait de même en détruisant les dix bombes qu’elle possédait (par le gouvernement de Klerk juste avant la fin du régime d’apartheid). Les USA et l’URSS ont été au premier rang des pays montrés du doigt pour leur surarmement nucléaire. Les deux pays sont tombés d’accord pour diminuer progressivement leur stock d’armes par un certain nombre d’accords. Le premier accord baptisé START I, signé en 1991, prévoit que les deux pays limiteraient à 6000 le nombre de leurs ogives nucléaires et à 1600 le nombre de leurs vecteurs (en fait des fusées). Cet accord vient à échéance en décembre prochain et les USA et la Russie semblent d’accord pour le renouveler et aller au-delà de ces réductions. L’accord SART I avait été complété, en 2002, par un traité signé par G.Bush et V.Poutine, sur la réduction des arsenaux stratégiques (SORT) qui fixait aux deux grandes puissances nucléaires un plafond de 1700 à 2200 têtes nucléaires en 2012. Le traité START I arrive à échéance en décembre prochain et le président Obama s’est engagé, sans doute déjà avec l’accord de la Russie, à le prolonger pour réduire encore les arsenaux nucléaires. Ces traités qui n’engagent que les USA et la Russie ont été complété par un traité d’interdiction totale des essais nucléaires, signé en 1996, par les 44 Etats qui possédaient à l’époque des réacteurs nucléaires, les USA et la Chine ne l’ont pas encore ratifié (la France, la Russie et le Royaume-Uni l’ont fait) mais n’ont plus procédé depuis sa signature à des essais nucléaires. B.Obama s’est engagé à faire ratifier le traité par le Sénat américain. Un système complet de détection sismique des explosions nucléaires de faible intensité a été construit à l’échelle mondiale, il offre une garantie contre d’éventuels essais clandestins. Aujourd’hui il existe un stock d’armes nucléaires considérable : -environ 4000 et 5000 ogives actives aux USA et en Russie (et quelques milliers en cours de démantèlement) – 300 ogives en France et environ 200 en Chine et au Royaume-Uni – quelques dizaines en Inde, au Pakistan, en Israël et quelques unités peut être en Corée du Nord.
La prolifération nucléaire est-elle en train de devenir une réalité et en quoi constitue-t-elle une menace? Il faut souligner d’abord que si l’énergie nucléaire a des avantages (elle permet de produire de l’énergie « massivement » et elle n’est pas source de gaz à effet de serre), elle est loin d’être une panacée. La maîtrise du nucléaire exige des compétences scientifiques et techniques importantes et le respect de règles de sécurité strictes pour éviter des accidents. Autrement dit, pour schématiser, c’est une énergie « étatique » et certains Etats considèrent que posséder le nucléaire est une question de prestige (c’était le cas de la France dans les années 1960). La majorité des scénarios énergétiques prévoient certes son développement mais pas de façon massive alors que l’on pronostique le doublement de la consommation mondiale d’électricité d’ici 2030 ; l’AIE dans son rapport 2008 prévoyait ainsi que la production mondiale d’électricité d’origine nucléaire augmenterait de 30% d’ici 2030, et la Chine prévoit « seulement » de doubler sa capacité nucléaire d’ici 2030. On peut observer ensuite que le TNP a, en partie, fait son office puisqu’il n’y a aujourd’hui « que » neuf pays détenteurs de l’arme nucléaire (en incluant la Corée du Nord). Par ailleurs si le surarmement nucléaire des années 1970 constituait un danger potentiel, la dissuasion nucléaire de l’époque a joué car les USA et l’URSS savaient que toute attaque nucléaire de l’un deux contre l’autre aurait été suicidaire ; les historiens discuteront pour savoir si cet « équilibre par la terreur » a contribué à la paix dans la guerre froide. Aujourd’hui, la situation est tout autre car la prolifération potentielle non contrôlée de combustibles nucléaires fait courir le risque d’une dispersion d’armes nucléaires dans de nombreuses régions politiquement fragiles (le Moyen Orient notamment ) où des Etats pourraient être tentés de s’en servir dans des conflits régionaux. Qui plus est l’existence d’organisations terroristes ou à tendance totalitaire constitue une menace supplémentaire sur le nucléaire dans la mesure où si celles-ci s’emparaient d’armes nucléaires elles pourraient être tentées de s’en servir. Ainsi le fait que le Pakistan possède des armes nucléaires non sécurisées (elles ne sont pas dotés d’un code de sécurité électronique bloquant la mise à feu de la bombe) alors que cet Etat est en totale déliquescence est-il un risque sérieux. On ne doit pas se cacher qu’il existe donc un problème de "gouvernance " du nucléaire.
Que faire (pour paraphraser Lénine….) ? Il faut d’abord que les cinq puissances nucléaires "initiales" (membres permanents du Conseil de sécurité) balayent devant leur porte, y compris la France qui a trop facilement tendance à dire qu’elle a une position « raisonnable » sur ce sujet, en s’engageant dans un effort très substantiel de désarment nucléaire comme elles se sont engagées à le faire en, signant le TNP. Les USA et la Russie semblent avoir pris conscience qu’il était nécessaire d’aller de l’avant (cf. Declan Butler « Obama’s nuclear-weapons-free vision », Nature, 458, p. 684, 9 April 2009, www.nature.com). Des personnalités, américaines pour la plupart (au nombre desquelles on trouvait Henry Kissinger et Georges Schultz) avaient publié en 2007 un manifeste dans le Wall Street journal (4 janvier 2007) appelant à créer un « monde libéré des armes nucléaires » qui témoignait d’un changement d’opinion aux USA à l’égard du nucléaire. Il faut ensuite organiser la « gouvernance » du nucléaire en renforçant le TNP qui doit être renégocié et prorogé en 2010. Dans cette perspective une série de mesures devraient être envisagées. La première consisterait à renforcer le pouvoir de contrôle de l’AIEA en permettant des contrôles impromptus de sites nucléaires (comme le prévoit un protocole additionnel au TNP que n’a pas igné l’Iran par exemple) et en lui en donnant les moyens techniques et financiers (le budget de l’AIEA reste fixé à un plancher de 400 millions de $ depuis de nombreuses années). La seconde viserait à constituer une « banque » mondiale de combustibles nucléaires (de l’uranium faiblement enrichi par exemple) alimentée par des usines sous contrôle international et qui permettrait de fournir des combustibles à des centrales nucléaires. La troisième mesure, assez radicale, serait un traité interdisant la production de matériaux fissiles à usage dans des armes nucléaires (de l’uranium fortement enrichi en particulier). Toutes ce mesures devraient être complétées par un programme d’aide aux pays désireux de se doter de centrales nucléaires avec des contrôles de sécurité très stricts. On observera, au passage pour terminer, que les accords de coopération nucléaire signés récemment par les USA et le France avec l’Inde pour aider ce pays non signataire du TNP à développer son nucléaire civil n’allaient pas dans le bon sens car ils décrédibilisent quelque peu les mesures du traité.
Le nucléaire n’a pas terminé son évolution scientifique et technique. C’est une technique lourde et complexe et il est fort possible que des percées surviennent qui modifieraient ses perspectives de développement (réglant mieux les problèmes de déchets par exemple ou utilisant une filière au thorium qui serait moins « proliférante »). L’histoire des techniques montre, en effet, que contrairement à ce que l’on pense dans une époque qui vit dans le court terme, la maturation des techniques est souvent lente (la machine à vapeur a connu son apogée vers 1900). Il est probable que le nucléaire connaîtra une telle évolution permettant peut être à des pays en cours de développement à se doter de centrales nucléaires adaptées à leur besoin si c’est nécessaire. Pour l’heure la priorité politique est de mener de front un désarmement nucléaire et un renforcement au niveau international les mesures de contrôle évitant une prolifération dangereuse des matériaux fissiles qui peuvent être utilisées à des fins militaires. Cela suppose que l’on donne des garanties d’accès aux techniques nucléaires aux pays qui acceptent ces mesures de contrôle (l’Iran par exemple). C’est le prix à payer pour accepter un développement raisonnable et raisonné du nucléaire….